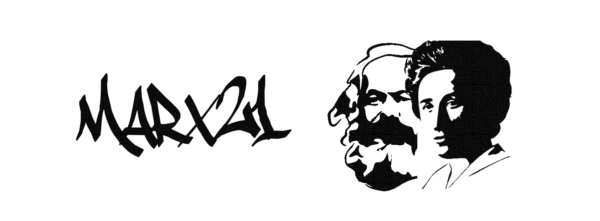Selon une analyse matérialiste, la contradiction entre le travail et le capital donne naissance à l’opposition de classe entre les salarié·e·s et les capitalistes propriétaires. Nulle part cette opposition n’est actuellement aussi flagrante que dans le rôle joué par Elon Musk. Avec son « Département de l’efficacité gouvernementale », l’homme le plus riche du monde supprime de manière radicale et brutale les services publics dans les domaines de la santé, des affaires sociales, de l’aide au développement ou de la recherche, au détriment de la majorité salariée aux États-Unis (et dans le monde entier). Pourtant, des milliers de travailleurs·euses l’acclament et ont élu son allié, Donald Trump, à la présidence. Comment se fait-il qu’une grande partie de la classe ouvrière vote à droite, contrairement à ses « intérêts de classe objectifs » ? Une analyse différenciée de la classe et surtout de la dévalorisation classiste et de la perte de statut aide à comprendre ce phénomène.
À gauche, on parle souvent de manière uniforme de la classe des salarié·e·s. Celle-ci est unie par la nécessité matérielle de vendre sa force de travail pour survivre. Les marxistes féministes telles que Nancy Fraser soulignent en outre l’importance du travail reproductif (souvent non rémunéré et féminin) et plaident pour une conception de la classe qui dépasse le simple travail salarié [1]. Aujourd’hui, la classe ouvrière est en grande partie féminisée et racisée. Néanmoins, la gauche marxiste continue d’affirmer que « nous tous » appartenons à la classe des salarié·e·s et que les travailleurs·euses manquent simplement d’une conscience de classe. C’est une vision trop simpliste qui occulte les différences, les divisions et les ressentiments profonds au sein du salariat.
Histoire d’une ascension sociale
J’en ai pris conscience une fois de plus en février dernier, lors d’une conférence d’Édouard Louis à Zurich. S’inscrivant dans la tradition des sociologues et écrivain·e·s français tels Pierre Bourdieu, Annie Ernaux et Didier Eribon, l’auteur a parlé du capitalisme, de la violence et des antagonismes de classe. Ses livres autobiographiques très commentés, En finir avec Eddy Bellegueule [2] et surtout Changer : méthode [3], ont façonné ma vision de la classe ouvrière comme peu d’autres. Louis y raconte son enfance dans un village industriel du nord de la France, marquée par la pauvreté, mais aussi par une société profondément patriarcale, empreinte de violence masculine, d’homophobie et de racisme. Son père et ses frères travaillent à l’usine, sa mère s’occupe des tâches ménagères et des soins. Il avait l’impression que tout le village votait pour le Front National.
Il raconte son coming out en tant qu’homme gay, son ascension sociale, ses années au lycée voisin, puis à l’École Normale Supérieure, une haute école parisienne très sélective. Il raconte ses expériences dans un monde nouveau, une haute société urbaine, éduquée, de gauche et queer, mais aussi les changements qu’il a dû opérer pour s’y intégrer. De son habitus ouvrier – sa façon de parler, de s’habiller, de se mouvoir, toute sa manière d’être – dont ‘il a tenté à tout prix de se défaire pour s’intégrer dans ce monde. Il raconte de manière impressionnante comment il a passé des nuits entières à dévorer les livres de Bourdieu, Sartre ou de Beauvoir afin de rattraper ce qui lui avait été refusé dans une famille ouvrière. Et enfin, il écrit aussi sur la honte qui l’a envahi lorsqu’il a pris conscience d’à quel point il s’était éloigné de son père, de sa mère et de tout son village – de comment il avait essayé de laisser derrière lui ses origines et, ce faisant, il avait inévitablement dévalorisé leur mode de vie. C’est une histoire de contrastes de classe, de violence et de classisme.
Classisme et capital culturel
Le classisme désigne la discrimination, la dégradation sociale et la dévalorisation des personnes appartenant à des classes sociales inférieures. Depuis les années 1990 au plus tard, le débat sociologique et social sur la discrimination fondée sur la classe sociale, qui était auparavant dominant, a été remplacé par la thématisation d’autres mécanismes de discrimination et d’exclusion plus faciles à saisir (racisme, sexisme, homophobie). Aujourd’hui, le classisme est socialement accepté, mais il reste tabou et se manifeste généralement de manière cachée [4]. Les personnes concernées ne disposent tout simplement pas du vocabulaire nécessaire pour parler de cette expérience.
Alors que le classisme fait son retour dans les sciences sociales, il est souvent rejeté par la gauche (à l’instar de l’approche intersectionnelle) comme contraire à une analyse matérialiste des classes et considéré comme postmoderne. On lui reproche de masquer les antagonismes de classe capitalistes et de mettre plutôt en avant les expériences individuelles. Cette critique est certes justifiée dans le contexte des publications en sciences sociales. Je pense néanmoins qu’il est essentiel de se pencher sur le classisme afin de comprendre les réalités quotidiennes des personnes concernées et de pouvoir développer des pistes politiques à ce propos.
Il me semble particulièrement utile de se concentrer sur la dimension éducative, en s’inspirant de la théorie de Pierre Bourdieu [5]. Celle-ci élargit la notion purement économique du capital et permet ainsi de différencier l’appartenance à une classe au-delà de la classe des salarié·e·s. Il distingue trois formes de capital qui déterminent le statut social d’une personne ou d’un groupe de personnes et peuvent être transmises de génération en génération : le capital économique, le capital social (au sens d’obligations et de relations sociales) et le capital culturel, qui englobe la dimension de l’éducation.
Dans ce dernier cas, Bourdieu distingue le capital culturel institutionnalisé (sous forme de diplômes), le capital culturel objectivé (sous forme de biens culturels, de livres, etc.) et le capital culturel incorporé, c’est-à-dire intériorisé (en tant que composante de l’habitus propre à chacun·e). Il est particulièrement important de noter que le capital culturel (et, dans une certaine mesure, le capital social) peut, dans certaines conditions, être converti en capital économique et vice versa, par exemple par l’acquisition de titres grâce à des frais d’études ou au temps investi. Cela contraste avec le fait que le capital culturel institutionnalisé et incorporé est généralement considéré comme la capacité légitime d’une personne et n’est pas du tout compris comme un capital transférable. En conséquence, les différences de classe à cet égard sont beaucoup plus difficiles à saisir et plus faciles à dissimuler. L’acquisition et la transmission du capital culturel sont nettement plus complexes que celles du capital économique.
Classisme de gauche
C’est précisément parmi les intellectuels de gauche urbains (qui disposent souvent d’un capital culturel élevé) qu’il existe une image positive, presque romantique, des travailleurs·euses, mais celle-ci est généralement outrée et en partie ironique. On s’efforce de s’habiller comme les travailleurs·euses, on écoute du rap de rue, on regarde les matchs de football du club ouvrier FC Zurich le dimanche après-midi. Pourtant, les images dévalorisantes et les préjugés à l’égard des travailleurs·euses vivant dans les zones rurales (qui disposent d’un capital culturel plus faible) sont profondément enracinés : ils-elles vivent dans des banlieues peu branchées, voire à la campagne, conduisent des voitures à essence, mangent de la viande, partent en vacances à Majorque (quand ils-elles en ont les moyens), ont des opinions racistes, sexistes et homophobes et votent pour l’UDC, l’AfD ou le Rassemblement national. En bref : les citadin·e·s, les gauchistes et les personnes instruites seraient progressistes, tandis que les travailleurs·euses ruraux et peu éduqués seraient conservateurs et réactionnaires. Derrière ces classifications et ces attributions se cachent souvent des différences de classe, notamment en termes de capital culturel, et donc une dévalorisation classiste venant de la gauche [6].
La vision simpliste selon laquelle nous, la gauche urbaine et hautement éduquée, aurions déjà compris et n’aurions plus qu’à enseigner aux travailleurs·euses que nous avons tous les mêmes intérêts de classe objectifs (afin de promouvoir la conscience de classe et la lutte des classes par le bas) témoigne d’une perspective élitiste et, dans une certaine mesure, aveugle aux questions de classe. Bien sûr, nous devons essayer d’unir et d’organiser la classe travailleuse – c’est la seule façon d’envisager un renversement du capitalisme inhumain et l’évolution vers une société émancipée. Mais pour cela, nous devons également avoir accès à cette classe. Cela signifie aussi s’intéresser à elle, l’écouter, comprendre ses réalités quotidiennes, et surtout, développer une attitude réfléchie et critique à l’égard du classisme, comme cela est désormais incontesté pour d’autres formes de discrimination et de dévalorisation (racisme, sexisme, homophobie).
Les travailleurs·euses ne votent pas simplement à droite parce qu’ils ont des opinions réactionnaires, mais parce qu’outre les conditions matérielles, le démantèlement social, l’exploitation et la peur du déclassement, ils subissent également une déclassification de leur statut de travailleurs·euses ainsi qu’une dévalorisation classiste – notamment de la part de la gauche urbaine qui se présente comme progressiste. Dans le même temps, la gauche doit trouver des stratégies pour contrer les attitudes racistes, sexistes et homophobes existant parmi les travailleurs·euses. C’est précisément là que l’organisation syndicale est cruciale. L’action collective permet non seulement de lutter contre les préjugés et les stéréotypes dévalorisants, mais aussi de reconnaître les intérêts communs de la classe, ce qui favorise l’émergence d’une conscience de classe à grande échelle. La classe des salarié·e·s en tant que facteur politique n’est pas donnée, elle naît dans la lutte commune.
La simultanéité d’une perspective matérialiste et critique du classisme
Dans son livre autobiographique, Retour à Reims [7], Didier Eribon décrit de manière impressionnante comment les habitant·e·s du village où il a grandi sont passés presque à l’unanimité d’un ancien électorat communiste au Front national, notamment en raison d’un sentiment d’abandon par la gauche urbaine, perçue comme élitiste. Nous ne devons pas reproduire cette attitude élitiste et cette dévalorisation classiste. Outre la nécessité urgente d’une gauche orientée vers la classe des salarié·e·s, qui prenne en compte les préoccupations réelles des gens (telles que la crise du logement, les coûts de la santé ou la prévoyance vieillesse), nous devons également développer stratégiquement (et humainement) une perspective réflexive et critique à l’égard du classisme. Sinon, nous perdrons la classe ouvrière au profit de la droite politique. Cela n’est pas en contradiction avec une conception marxiste matérialiste des classes, mais la complète et l’élargit, tout comme le font les théories et les pratiques postcoloniales, antiracistes et (queer) féministes.
* Elias Brandenberg est membre du Mouvement pour le socialisme à Zurich. Cet article a été traduit par nos soins de l’original allemand, paru dans Antikap, n° 22, printemps 2025, pp. 38-40. Disponible en ligne en allemand.
NOTES
[1] Fraser, N., Le capitalisme cannibale, Marseille, Agone, 2025.
[2] Louis, É., En finir avec Eddy Bellegueule, Paris, Seuil, 2014.
[3] Louis, É, Changer : méthode, Paris, Seuil, 2021.
[4] Wellgraf, S., The Hidden Injuries of Class. Mechanismen und Wirkungen von Klassismus in der Hauptschule. In : Giebeler et al. (éd.), Intersektionen von race, class, gender, body : Theoretische Zugänge und qualitative Forschungen in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit, 2013, pp. 39-59.
[5] Bourdieu, P., Capital économique, capital culturel, capital social, pp. 229-242, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
[6] Brandenberg, E., Hilkersberger, B., & Streckeisen, P. (2024). Le classisme dans les régions de montagne : nouvelle lecture des relations entre « autochtones » et « nouveaux arrivants ». Archives suisses des traditions populaires, 120, p. 53-72.
[7] Eribon, D., Retour à Reims, Paris, Fayard, 2009.