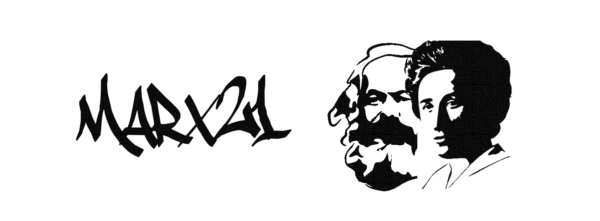Nous avons traduit cet article de Fabrizio Burattini sur le bilan des trois ans au pouvoir du gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni en raison de sa grande qualité. Nous regrettons cependant, que dans sa conclusion, il passe trop rapidement sur la signification sociale et politique des manifestations et mouvements de grève de masse de fin septembre et début octobre en solidarité avec la Palestine. À ce propos, nous renvoyons aux deux articles que nous avons déjà publiés: 22 septembre, L’Italie en grève et dans la rue pour Gaza; et Entretien avec les dockers génois qui ont enflammés l’Italie. (SP)
Giorgia Meloni a pris ses fonctions au palais Chigi, siège de la présidence du Conseil des ministres italien, il y a précisément trois ans. Sa nomination était le résultat prévisible, mais désastreux, des élections de septembre 2022, lorsque la coalition de droite (dont Fratelli d’Italia était de loin le premier parti) a remporté la victoire grâce à un taux d’abstention important (36 %), mais surtout, grâce à une loi anti-proportionnelle approuvée par les précédents gouvernements de centre gauche et à la profonde division entre les autres forces politiques qui constituaient le front hétérogène de l’opposition au parlement.
La droite, avec ses 12 millions de voix, soit un pourcentage inférieur à 44 % des suffrages exprimés et 26 % seulement de l’électorat (46 millions de personnes), a élu près de 60 % des député·es et des sénateurs·trices. Comme nous l’avons relevé à ce moment dans un commentaire, « la victoire de Giorgia Meloni et de Fratelli d’Italia a une valeur symbolique sans précédent dans l’histoire de la République : l’Italie tombe entre les mains d’une coalition dominée par les héritiers de Mussolini, d’Almirante et de Rauti ».
Il ne faut pas non plus négliger les autres facteurs qui ont contribué au succès du parti héritier du fascisme, notamment les transformations culturelles et institutionnelles déjà imprimées au pays par les gouvernements Berlusconi, la disparition progressive d’une gauche capable de représenter une alternative pour les classes populaires, les contraintes institutionnelles imposées à la politique par les gouvernements de gauche et les gouvernements « techniques », les choix fortement « socio-libéraux » de ces mêmes gouvernements, l’acquiescement obstiné à ces choix de la part des syndicats majoritaires, et l’échec des illusions créées dans le pays par la démagogie du Mouvement 5 étoiles.
Il n’en reste pas moins que la victoire de Giorgia Meloni semble beaucoup plus solide et « structurée » que celle de Silvio Berlusconi, il y a près de trente ans, qui avait été continuellement marquée par un mélange entre les objectifs politiques de la droite et les intérêts personnels et entrepreneuriaux du Premier ministre. Contrairement à Berlusconi, Giorgia Meloni se présente et, dans une certaine mesure, est une « politicienne pure ». Elle est née (en 1977) et a grandi dans les milieux louches de l’extrême droite romaine. Elle était militante de la jeunesse néofasciste depuis l’âge de 15 ans et elle s’est toujours engagée dans des activités politiques et a occupé des fonctions institutionnelles de plus en plus importantes, de conseillère municipale de la capitale à députée, ministre et, aujourd’hui, présidente du Conseil.
Sa réponse à une interview a fait la une des journaux lorsqu’une polémique a éclaté entre elle et Berlusconi, peu après sa nomination. Elle lui a répondu sèchement : « Je ne suis pas susceptible de faire l’objet de chantage », affirmant ainsi que, contrairement à l’ancien leader de Forza Italia, elle n’avait d’autres intérêts à cacher que ceux de la politique.
Il faut dire qu’elle n’a jamais voulu cacher ses racines politiques fascistes. Face aux insistances inefficaces de l’opposition et de certains médias pour qu’elle se déclare « antifasciste », elle a toujours réussi à esquiver la question. Et ses prises de distance par rapport au fascisme historique ont toujours été tactiquement limitées à certaines questions relativement secondaires. Elle a même réussi à consolider ses relations avec la communauté juive, en particulier celle de Rome, autrefois l’un des bastions de la gauche, en faisant élire sur ses listes pour le Sénat sa porte-parole, Ester Mieli, petite-fille d’un déporté à Auschwitz.
Et ce, malgré les nombreuses enquêtes journalistiques qui ont révélé que la base et la nomenklatura de Fratelli d’Italia continuent de cultiver le mythe mussolinien, l’idéologie fasciste et même la haine antisémite.
Une économie sous perfusion
Le bilan de ces trois années de gouvernement est marqué par la situation économique du pays et par une conjoncture plutôt déprimée, avec les restrictions budgétaires que l’Italie connaît depuis des années en raison de sa dette publique abyssale (3 053 milliards d’euros, chiffres de juillet 2025, soit près de 140 % du produit intérieur brut). La politique du gouvernement, notamment grâce à la réduction des impôts (en particulier en faveur de sa base sociale à la tête des petites entreprises, du commerce et des professions libérales), a entraîné une augmentation de la dette de près de 300 milliards au cours des trois dernières années.
Malgré cela, le gouvernement peut se targuer d’une baisse significative du spread entre le taux d’intérêt des titres d’État italiens et celui des titres allemands, qui est passé de 244 à 86 entre 2022 et aujourd’hui.
Le spread mesure ici la différence de taux d’intérêt entre la dette publique allemande et italienne en « points de base » — un « point de base » représente un centième de point de pourcentage. Ainsi un spread de 244 indique un taux d’intérêt de l’Italie supérieur de 2,4 points de pourcentage à celui de l’Allemagne, tandis qu’un spread de 86 indique un taux d’intérêt supérieur de 0,86 point de pourcentage [NdT].
Naturellement, la crise économique qui affecte l’Allemagne depuis quelque temps a fortement contribué à la hausse du rendement de ses obligations, mais il reste certain que le rendement des Bons du Trésor italiens est passé de 4,79 % à 3,57 % en trois ans, indiquant que les « marchés » ont considérablement renforcé leur confiance dans l’économie italienne, car elle est entre les mains d’un gouvernement qu’ils considèrent « plus fiable », ce qui s’est d’ailleurs traduit par une légère amélioration de la notation définie par les principales agences de notation financière et que Giorgia Meloni a présentée comme « la confirmation que la voie empruntée par le gouvernement était la bonne ».
Le PIB de l’Italie à prix constants est resté pratiquement stable au cours des trois années du gouvernement Meloni, avec une croissance légèrement inférieure à 1,5 % entre le quatrième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2025. Malgré cela, le gouvernement se vante d’une tendance à la hausse du taux d’activité qui aurait atteint 62,80 % cet été (contre 54,70 % en 2013).
En Italie, le taux d’activité est calculé selon la formule suivante :
Actifs occupés + chômeurs / population de 15 ans et plus X 100
Ces résultats, par ailleurs très modestes, même dans un contexte mondial déprimé et marqué par le ralentissement du commerce international, sont largement « dopés » par les 194 milliards d’euros versés par l’Union européenne (dans le cadre du programme post-Covid Next Generation UE), en partie sous forme de subventions (71,8 milliards) et en partie sous forme de prêts à taux préférentiels (122,6 milliards). Il s’agit de chiffres énormes qui pleuvent sur les entreprises italiennes, soutenant manifestement (d’au moins un point de pourcentage, dit-on) le PIB et l’emploi.
Malgré les déclarations de la droite sur les dangers du « remplacement ethnique », le déclin démographique reste un problème non résolu. En dix ans, la population italienne est passée de 60,2 millions en 2016 à 59,0 millions cette année. Cette diminution serait encore plus prononcée en l’absence de l’afflux massif d’immigrant·es ces dernières années. En effet, le nombre de résidents étrangers est passé d’environ 500 000, au début des années 1990, à plus de 5 millions aujourd’hui.
Parmi eux, 4,3 millions bénéficient de la Prévoyance sociale, dont 3,8 millions sont actifs·ves, plus de 300 000 sont retraité·es et environ 250 000 sont bénéficiaires de prestations de soutien au revenu (comme le chômage partiel, les indemnités d’invalidité ou les allocations de chômage). Outre la très forte baisse des naissances (on ne prévoit pas plus de 340 000 naissances en 2025, soit encore 8 % de moins qu’en 2024), il ne faut pas oublier que chaque année, environ 100 000 jeunes (généralement titulaires d’un diplôme universitaire) émigrent vers d’autres pays de l’UE ou hors de l’UE.
Des salaires réels inférieurs à ceux de 2008
La situation des classes populaires se reflète aisément dans les prix à la consommation qui, au cours des cinq dernières années (2021-2025), ont augmenté d’environ 17 %, alors que les salaires moyens n’ont crû que de 9,6 %, ce qui représente une perte de 8 points de pouvoir d’achat, soit l’équivalent d’un mois de salaire. L’Organisation internationale du travail (OIT) a souligné à plusieurs reprises que l’Italie est l’un des rares pays du G20 à avoir aujourd’hui des salaires inférieurs à ceux de 2008.
La pauvreté (en particulier dans certaines régions du pays) constitue une véritable urgence chronique. Entre 2022 et 2024, les familles en situation de pauvreté absolue sont passées de 8,3 % à 8,5 % du total des familles résidentes (soit environ 2 millions 234 mille familles ; alors qu’elles ne représentaient « que » 6,2 % en 2014) et les personnes en situation de pauvreté absolue de 9,7 % à 9,8 % (plus de 5,7 millions de personnes). Ce phénomène est en augmentation et s’aggrave, tant en raison de l’inflation qui appauvrit les familles qui se trouvaient juste au-dessus du seuil de pauvreté que de la suppression du revenu de citoyenneté en 2023, qui a laissé de nombreuses familles déjà pauvres sans aucun soutien au revenu. Selon l’Institut de statistique, le taux de population menacée de pauvreté est de 23,1 % en 2024.

La pauvreté absolue touche en particulier les mineurs, plus nombreux dans les familles pauvres : les moins de 18 ans en situation de pauvreté absolue représentent 14 % du total (1,3 million). Elle touche également une partie importante de la population active (les working poor) : les familles dont le chef de famille est employé et vit dans une situation de pauvreté absolue sont passées de 8,3 % à 9,1 % entre 2022 et 2023. L’opposition dans son ensemble a souligné la nécessité d’instaurer une loi sur le « salaire minimum » (réussissant même à modifier la position de certains syndicats, tels que la CGIL et l’UIL, qui y étaient auparavant opposés), mais le gouvernement a fait échouer toutes les propositions en ce sens.
Depuis de nombreuses années, l’Italie demeure la deuxième puissance manufacturière du continent européen, mais son industrie reste fortement caractérisée par une faible productivité du travail (en 2024, 65 euros par heure travaillée, contre 75,1 en France). Cette donnée contribue également à relativiser, voire à annuler, les données triomphalistes du gouvernement concernant la croissance de l’emploi et sa qualité. En 2023, par exemple, les heures travaillées ont augmenté de 2,7 %, tandis que la valeur ajoutée n’a augmenté que de 0,2 %, ce qui indique qu’une grande partie des entrepreneurs, en particulier les petits et les très petits, préfèrent embaucher des salarié·es à bas salaire plutôt que de faire des investissements innovants. Ce n’est pas un hasard si la Commission européenne, dans ses rapports, place l’Italie à la quatorzième place seulement dans le classement des pays les plus innovants de l’UE en 2025.
La petite croissance de l’emploi, dont se vante le gouvernement de droite et d’extrême droite, montre toutefois des signes de fragilité. En effet, le nombre de personnes âgées de plus de 50 ans occupant un emploi augmente, tandis que celui des jeunes diminue, ce qui montre les conséquences sur l’emploi du relèvement de l’âge de la retraite, décrété en 2011 par le gouvernement « technique » de Mario Monti et jamais modifié par les gouvernements suivants. Les personnes âgées restent plus longtemps au travail, ce qui fausse les statistiques sur l’emploi, au détriment d’un rajeunissement et d’une rotation plus significatifs de la main-d’œuvre.
Le deuxième pays manufacturier d’Europe se désindustrialise
Le phénomène dit de « désindustrialisation » a commencé en Italie (comme dans une grande partie du monde occidental) dès les années 70 et s’est accéléré dans les années 90, avec une réduction progressive du poids du secteur manufacturier au profit des services. Mais ces dernières années, la politique économique du gouvernement Meloni, dans le but de renflouer les caisses pour équilibrer les comptes publics, a facilité un nouveau processus de privatisation d’entreprises « stratégiques », avec la vente par l’État de sociétés autrefois essentielles au développement économique du pays. Et ces privatisations ont eu des répercussions importantes sur l’emploi.
Les aciéries de Tarente (anciennement Italsider, anciennement ILVA, aujourd’hui « Acciaierie d’Italia Spa ») sont en proie, à la suite de leur privatisation dans les années 80, à une crise environnementale et professionnelle très grave, qui dure depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, le gouvernement prévoit essentiellement de les céder à la société financière américaine « Bedrock Industries », qui demande que la cession s’accompagne d’un financement public de 700 millions d’euros à fonds perdu pour procéder à la « décarbonisation » des installations. Bedrock prévoit également une réduction massive de 7 000 emplois sur les 10 000 actuellement occupés.

Il y a tout juste un an, le gouvernement a cédé le réseau fixe de TIM (anciennement Telecom Italia) à un consortium dirigé par le fonds américain KKR, ce qui a entraîné une réduction des effectifs de TIM de 37 000 à 17 300 employé·es. Dès 2022, la compagnie aérienne nationale Alitalia (aujourd’hui ITA) a été privatisée et, il y a quelques mois, le gouvernement Meloni a décidé de la céder progressivement à Lufthansa, avec l’annonce de cette dernière qu’elle ne pas réintégrera pas les 2 000 travailleur·euses actuellement au chômage technique. La marque pétrolière IP (Italiana Petroli), qui faisait autrefois partie du groupe ENI, est en passe d’être cédée au groupe azerbaïdjanais Socar pour 3 milliards d’euros, dans le cadre de la « diversification des sources d’énergie », à la suite à la guerre de la Russie en Ukraine.
Les usines de production ex-Fiat (aujourd’hui Stellantis) sont en cours de démantèlement depuis des années et la crise du marché automobile n’a fait qu’accélérer cette tendance. L’ancienne usine Fiat IVECO (véhicules industriels) a déjà été cédée en partie à l’indien Tata Motors et, pour ce qui est du secteur des véhicules à usage militaire, à un partenariat entre Leonardo et l’allemand Rheinmetall. Au total, cela met en péril plus de 10 000 emplois supplémentaires. Le gouvernement prévoit également de reconvertir l’industrie automobile italienne dans la production militaire, en accordant de nouvelles aides publiques à Stellantis. Malgré cela, l’entreprise a continué à distribuer des dividendes à ses actionnaires, grâce à la délocalisation de la production, à la compression des salaires, aux généreuses aides publiques et au transfert des bénéfices vers des « paradis fiscaux ».

La croissance des inégalités
Dans le secteur bancaire, l’affaire Monte dei Paschi di Siena (MPS) est particulièrement frappante. Il s’agit de l’une des plus anciennes banques, autrefois détenue en grande partie par l’État (plus de 60 % du capital) et en difficulté depuis longtemps, qui a été « assainie », il y a quelques années, grâce à l’octroi de 5,4 milliards d’euros prélevés sur les fonds publics. Maintenant que la banque est redevenue « attractive », le gouvernement veut vendre les 11 % d’actions encore détenues par l’État. Entre-temps, MPS a acquis la principale « banque d’affaires » du pays (Mediobanca), en faisant gagner à ses principaux actionnaires (les familles Del Vecchio et Caltagirone et le fonds américain BlackRock) plus de 1,5 milliard d’euros de bénéfices, sur lesquels rien ne sera versé au fisc, car tous résident dans des paradis fiscaux.
En 2024, les banques italiennes ont enregistré un nouveau record en termes de bénéfice net, soit 46,5 milliards d’euros, avec une croissance de 5,7 milliards (+14 %) par rapport à 2023. Le montant total des bénéfices réalisés par les banques au cours de la période triennale Meloni (2022-2024) atteint 112 milliards, grâce notamment aux taux d’intérêt élevés décidés par la BCE. Dans les manœuvres financières des dernières années, le gouvernement avait à plusieurs reprises proclamé son intention de prélever un impôt (très modeste, d’ailleurs, pas plus de 2 milliards) sur ces bénéfices exceptionnellement élevés. Mais l’opposition des banquiers, représentés au sein du gouvernement par Forza Italia, a rapidement conduit l’exécutif à renoncer. Le ministre des Finances Giancarlo Giorgetti (Lega) paraît vouloir retenter le coup cette année, mais il semble que les difficultés resteront les mêmes que celles des années précédentes.
Des lois pour consolider le consensus
L’activité législative du gouvernement a été particulièrement limitée. Malgré les pressions de l’UE et la politique communautaire de « protection de la concurrence », le gouvernement Meloni a choisi la voie de la « protection contre la concurrence » et a continuellement renouvelé les concessions monopolistiques et les rentes accordées certaines corporations dont la droite tire un soutien électoral important (établissements balnéaires, taxis, notaires, etc.).
Dès sa première manœuvre financière, à la fin de l’année 2022, il a également choisi, en la renouvelant et en l’élargissant au cours des années suivantes, de mener une politique fiscale ouvertement favorable à certaines catégories de revenus. Ainsi, alors que les salarié·es et les retraité·es continuent d’être imposés selon des taux progressifs (23 % pour les revenus jusqu’à 28 000 euros, 35 % pour les revenus jusqu’à 50 000 euros, 43 % pour les revenus supérieurs à 50 000 euros), les professions libérales et les petites entreprises individuelles sont soumises à ce qu’on appelle la « flat tax » à 15 % (réduite à 5 % pendant 5 ans pour les « nouveaux entrepreneurs »). Il en résulte, qu’à revenu égal, un·e salarié·e peut payer jusqu’à trois fois plus d’impôts qu’un travailleur·euse indépendant. Il est clair que la droite a tiré un avantage électoral de cette opération, surtout en Italie, où le poids du travail indépendant et des petites entreprises est bien plus élevé que dans la moyenne des pays développés.
Giorgia Meloni et le gouvernement, dans la parfaite continuité de Berlusconi, ont persévéré dans leur politique d’indulgence envers la fraude fiscale colossale (environ 100 milliards d’euros par an) et l’évasion fiscale tout aussi importante (en 2024, les contribuables endettés auprès du fisc étaient environ 23 millions, avec des dettes s’élevant à la somme colossale de près de 1 300 milliards d’euros).
Cette politique s’est traduite par des opérations démagogiques et propagandistes, comme les déclarations de la Première ministre, en 2023, à Catane (en Sicile, région où l’évasion fiscale atteint des niveaux records et où la mafia règne toujours), où elle a comparé la lutte contre l’évasion fiscale au « racket d’État », c’est-à-dire aux « contributions » que le crime organisé extorque avec violence aux citoyen·nes. Mais elle s’est également et surtout manifestée par de nombreuses mesures d’amnistie fiscale (une vingtaine au cours de ses trois années de gouvernement) qui ont annulé ou réduit à des montants dérisoires les dettes fiscales des contribuables fraudeurs ou défaillants.
Ainsi, face à la pénalisation de tous les citoyen·nes à revenu fixe (et retraité·es), les inégalités continuent de croître en Italie. La richesse immobilière et financière italienne, qui a explosé ces dernières années, s’élève à 11 700 milliards (cinq fois le PIB) et place le pays à la huitième place du classement mondial en termes de patrimoine financier. Le pays compte 517 000 millionnaires, c’est-à-dire des personnes qui détiennent un patrimoine d’au moins un million de dollars de fortune mobilière, soit moins de 1 % de la population. Les personnes qui détiennent un patrimoine supérieur à 100 millions de dollars de fortune mobilière en Italie sont au nombre de 2 600. Cette rentabilité des activités financières et le fait qu’elles soient peu imposées déclenchent également une « spirale de rentes » qui détourne les investissements de l’économie productive.
Le gouvernement, par d’autres opérations démagogiques et propagandistes, vise également à inciter d’importants secteurs de l’entrepreneuriat et de la finance à s’organiser pour spéculer sur des régions du monde, victimes de guerres et de dévastations. En janvier 2024, Giorgia Meloni a organisé à Rome un « sommet Italie-Afrique » auquel ont participé des représentants de 45 États africains, au cours duquel la Première ministre a présenté les hypothèses de « partenariat » prévues par le « Plan Mattei ».

Mais ce n’est pas tout. En juillet de cette année, elle a organisé, toujours à Rome, la « Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine », en collaboration avec le gouvernement de Kiev, envisageant d’importants investissements dans le pays dévasté par l’invasion russe. Dans les prochains jours, nous pouvons en être sûrs, le gouvernement s’efforcera de faire participer les industries italiennes à la « reconstruction de Gaza », si l’accord fragile conclu entre Netanyahu et le Hamas tient bon.
Racisme et politiques sécuritaires
L’activité du gouvernement s’est donc manifestée davantage sur le plan politique que sur le plan purement législatif. Car, par exemple, même les nombreuses et importantes initiatives visant à « empêcher l’immigration clandestine » n’ont pas donné de résultats concrets significatifs, si ce n’est celui de renforcer l’image d’un gouvernement « fort avec les faibles », une image utile pour préserver le soutien politique et électoral de larges pans de l’électorat infectés par le racisme. Une série de décrets, adoptés en 2023, a servi cet objectif, comme celui qui a fortement entravé l’activité des navires des ONG engagés dans le sauvetage des migrant·es naufragés en Méditerranée, celui adopté après le massacre de Cutro (qui a fait plus de 100 morts par noyade) ou celui qui a prolongé jusqu’à 18 mois la durée maximale de séjour dans l’enfer des « centres de rapatriement » (CPR).

Le protocole d’accord conclu avec le gouvernement albanais en février 2024, qui a conduit à la construction de deux CPR dans ce pays, une construction très coûteuse et jusqu’à présent pratiquement inutilisée, constitue un cas à part.
Toute l’affaire qui a opposé la volonté du gouvernement de fixer à sa guise les pays considérés comme « sûrs » pour le rapatriement des demandeur·euses d’asile et les initiatives contraires de nombreux juges italiens (et de la magistrature européenne) a également été utile à la propagande raciste du gouvernement et à son initiative contre l’indépendance de la magistrature.
En matière de politique économique, outre les choix d’amnistie en faveur des fraudeurs, le gouvernement a adopté d’importantes mesures d’allègement pour les entreprises, telles que la création d’une zone économique spéciale (ZES) unique qui couvre tout le sud du pays (avec les facilités fiscales et réglementaires correspondantes, tant contractuelles qu’environnementales, pour les entreprises qui opèrent dans le Mezzogiorno). Au profit des employeurs, il a également été décidé de prolonger la réduction du « coin fiscal », qui a certes permis d’ajouter quelques dizaines d’euros supplémentaires aux salaires des salariés aux dépens du budget public, mais dans le but explicite de réduire la pression salariale et syndicale pour le renouvellement des conventions collectives et l’augmentation des salaires.
La réduction du « coin fiscal » est un tour de passe-passe qui vise à augmenter le salaire net en réduisant les cotisations sociales à charge du patronat. La hausse du salaire direct est ainsi compensée par une baisse du salaire indirect (NdT).
En outre, la possibilité pour les entreprises de recourir à des sous-traitants et d’utiliser, même en l’absence de motifs valables, des contrats de travail à durée déterminée a également été élargie.
Des initiatives législatives importantes et inquiétantes ont été adoptées sur le plan répressif. Dès sa première semaine de mandat, en 2022, le gouvernement a promulgué le « décret Rave », une mesure imposant des amendes substantielles et des peines de prison pour les rassemblements de plus de 50 jeunes ne bénéficiant pas d’une autorisation préalable.
Mais la loi la plus significative à cet égard est celle qui a été adoptée en avril dernier par décret, contournant ainsi le vote du Parlement, malgré la large majorité dont dispose le gouvernement dans les deux chambres. Il s’agit du « décret sécurité », qui introduit de nouvelles infractions en matière d’ordre public (blocage de routes, occupation de bâtiments, retrait de la nationalité pour les étranger·ères ayant obtenu la nationalité italienne et condamnés, même pour des délits mineurs, emprisonnement obligatoire même pour les femmes ayant des enfants de moins d’un an, libre usage des armes, y compris des armes à feu, par la police, répression accrue de toute protestation dans les prisons, etc.). Ce décret aggrave, en termes de répression, le Code pénal hérité par la République italienne du régime fasciste.

Mais les intentions du gouvernement vont bien au-delà. Il y a un an, le Parlement a approuvé la loi sur l’« autonomie différenciée », fortement souhaitée par la Lega de Matteo Salvini, afin de tenter d’éliminer toute forme de solidarité fiscale entre les régions les plus riches et les plus pauvres du pays et de donner des pouvoirs plus importants et quasi illimités aux dirigeant·es des régions les plus riches. Cette loi, adoptée avec le soutien de l’ensemble de la majorité de droite, en juin 2024, a été partiellement amendée par un arrêt de la Cour constitutionnelle de décembre 2024, mais elle continue de représenter une importante violation de la constitution adoptée par la République italienne en 1948.
Une autre loi de réforme constitutionnelle (souhaitée en particulier par Forza Italia) a récemment été adoptée par la majorité gouvernementale en matière de justice, séparant les carrières des juges de celles des procureurs et modifiant profondément le système d’autogouvernance de la magistrature, dans le but explicite de la subordonner au pouvoir exécutif, et donc, de porter atteinte à la séparation des pouvoirs également prévue par la Constitution, déjà fortement compromise par l’abus des décrets d’urgence (le gouvernement Meloni a adopté pas moins de 91 décrets-lois en trois ans). Un abus qui vide le Parlement de son rôle en le subordonnant au gouvernement. Conformément aux dispositions constitutionnelles, cette réforme de la magistrature sera soumise au printemps prochain à un référendum populaire de confirmation. Mais les sondages, à ce jour, laissent présager un résultat favorable à la droite.
Vers un pouvoir constitutionnel autoritaire
Cela dit, le point principal du programme de réforme de la Constitution proposé par la droite est la « réforme du Premier ministre », une refonte complète du fonctionnement institutionnel du pays. Cette proposition a été qualifiée par Giorgia Meloni de « début de la Troisième République » (la « deuxième » aurait été celle dominée par Berlusconi), la « mère de toutes les réformes ». Il s’agit d’un projet de très sérieuse altération de l’architecture institutionnelle adoptée par l’Italie après vingt ans de fascisme, un coup que Giorgia Meloni entend porter à la structure institutionnelle parlementaire du pays, sans autre motivation que l’obsession idéologique des postfascistes italiens de la centralisation des pouvoirs.
La proposition est présentée comme un remède à l’instabilité gouvernementale qui a caractérisé le pays dans la seconde moitié du siècle dernier. Mais aujourd’hui, en particulier dans cette législature, cette instabilité n’a plus cours. À tel point que, pour tous les observateurs, l’Italie de Giorgia Meloni apparaît comme un modèle de stabilité, dans une Europe où de nombreux pays sont en proie à de profondes crises, à commencer par la France de Macron.
Le gouvernement Meloni est en effet en passe de devenir le plus long de l’histoire d’après-guerre du pays. La réforme du poste de Premier ministre n’a donc rien à voir avec la soi-disant « gouvernabilité ». Dans les visées de la Première ministre et de ses autres promoteurs, elle vise surtout à signifier politiquement et symboliquement le dépassement définitif des racines antifascistes et démocratiques de la Constitution de 1948 et à créer, parmi un électorat populiste beaucoup plus large, l’illusion d’un renouveau qui promet de sortir le pays des difficultés des dernières décennies.
Le mécanisme institutionnel abscons identifié par les rédacteurs du projet réduit à néant le rôle des parlementaires et des chambres, qui deviennent de simples instances de ratification des décisions prises par le gouvernement et son Premier ministre. Il s’agirait, même formellement, d’une « dictature de la majorité », d’une majorité qui, en outre, selon les nouvelles règles électorales, pourrait disposer d’au moins 55 % des parlementaires, même avec 30 % seulement des voix, qui plus est de l’électorat qui s’exprime, dans un contexte où l’abstentionnisme ne cesse de croître.
Le pouvoir exécutif (c’est-à-dire le gouvernement) deviendrait indépendant du parlement, car l’élection directe du Premier ministre en ferait le pouvoir central, largement au-dessus de tous les autres organes institutionnels (président de la République et parlement compris), structurellement affaiblis. Il s’agirait d’une « démocratie » analogue à celle de nombreux « amis » de Giorgia Meloni, en particulier de celle du Hongrois Viktor Orban.
Cette réforme est encore en discussion au Parlement, et le gouvernement (à moins que des « fenêtres » d’opportunité imprévisibles ne se présentent) choisira probablement de la laisser mûrir avec le temps, peut-être en reportant son adoption définitive à la prochaine législature, qui sera élue à l’automne 2027. En effet, il est tout à fait prévisible que la réforme fera l’objet d’un référendum de confirmation, et les référendums de confirmation sur les réformes constitutionnelles se sont souvent transformés en désaveux retentissant des gouvernements. Il suffit de se rappeler les 60 % de « non » qui ont balayé le gouvernement Renzi en 2016.
Mais cette fois-ci, l’épreuve sera particulièrement difficile pour l’opposition, car, pour empêcher la réforme, il faudra « défendre » une Constitution qui, grâce à des modifications répétées, n’est plus celle fondée sur le « compromis social » antifasciste de 1948. Et aussi parce que cette Constitution a douloureusement montré, au cours de ces dernières décennies, son caractère déclamatoire, trahissant dans la pratique tous les engagements d’égalité et de justice promis dans le texte.
La fiabilité internationale
Parmi les succès de Giorgia Meloni, il ne faut pas négliger sa capacité à s’intégrer efficacement dans la politique de l’Union européenne, même si ce choix contredit de manière flagrante ses prises de position démagogiques contre les « technocrates de Bruxelles », adoptées lorsqu’elle était encore dans l’opposition. Il faut dire qu’après un certain scepticisme initial, la Commission européenne et sa présidente Von Der Leyen ont largement ouvert la porte à la collaboration avec la Première ministre italienne.
Cette collaboration s’est traduite par une contribution du gouvernement italien à la politique de l’Union européenne en matière d’immigration — révision du règlement de Dublin, nouvelles règles relatives au droit d’asile et au rapatriement —, d’environnement — réécriture du Green Deal européen – et de politique économique — assouplissement de certaines règles du pacte de stabilité et de croissance.
Cette collaboration a conduit la droite et l’extrême droite italiennes au pouvoir à se démarquer lors du vote sur la nouvelle commission — Fratelli d’Italia et Forza Italia ont voté en faveur d’Ursula Von Der Leyen, tandis que la Lega a voté contre, avec le reste de l’extrême droite européenne. En contrepartie, Fratelli d’Italia a obtenu la nomination de l’un des siens , Raffaele Fitto, au poste de vice-président exécutif. En faisant le bilan des politiques européennes d’autres leaders de droite (par exemple, Matteo Salvini), Giorgia Meloni a compris qu’une approche frontalement « souverainiste » et anti-européenne n’était pas très payante. Elle a donc mis en place et continuera à mettre en œuvre une politique d’intégration graduelle au sein des institutions de l’UE, enregistrant déjà des succès manifestes.
En matière de politique étrangère, certaines divergences persistent entre les partis de la coalition de droite. Fratelli d’Italia et Forza Italia sont plus clairement atlantistes vis-à-vis de l’Ukraine, mais l’activisme de Trump semble faire l’unanimité parmi eux. Giorgia Meloni est certainement la mieux placée pour tirer profit de l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite américaine.
Étant donné que le gouvernement italien a été le premier, parmi les principaux pays occidentaux, à tomber entre les mains de l’extrême droite, il faut reconnaître que Giorgia Meloni a réussi à normaliser la présence d’une extrême droite fasciste (ou du moins post-fasciste) à la tête de la troisième économie européenne, devenant ainsi une référence internationale pour tous les partis de droite. Elle a habilement réussi à s’entourer d’une aura de respectabilité, à se doter d’une image institutionnelle « modérée », à s’imposer comme un acteur essentiel dans la résolution des principaux défis de l’UE, non seulement sur l’Ukraine, mais aussi sur d’autres questions.
Elle a réussi à établir une relation cordiale et symboliquement significative avec la présidente de la Commission. Elle a même organisé avec elle une visite conjointe sur l’île de Lampedusa, principale destination des migrants et migrantes en provenance d’Afrique du Nord, dans le but d’afficher leur entente et leur collaboration sur le sujet délicat de l’immigration. En effet, l’ensemble de la politique européenne semble se rapprocher des positions xénophobes et racistes de la droite italienne à ce sujet.

Dans le même temps, elle a réussi à combiner tout cela avec une entente affichée avec l’administration Trump, qui lui rend en quelque sorte la pareille en la présentant comme une interlocutrice privilégiée.
Malgré les critiques largement inefficaces que la Lega de Matteo Salvini et du général néofasciste Roberto Vannacci adresse à Giorgia Meloni sur sa droite, il faut dire que cette dernière, grâce à son pragmatisme, a réussi à gagner de plus en plus le soutien des patrons, même les plus puissants, autrefois perplexes face au « souverainisme » de l’extrême droite, à son gouvernement et à sa politique.
Il faut également ajouter que son « modèle » contribue à la « montée » au pouvoir d’autres partis d’extrême droite au niveau international, car il incite des secteurs de plus en plus larges des classes dominantes à dire : « Eh bien, vous voyez, en fin de compte, il n’y a pas lieu d’avoir peur d’eux, au contraire, comme le montre Giorgia Meloni, ils peuvent faire un travail utile pour nous ».
L’agressivité réactionnaire envers ceux qui ne sont pas d’accord
Contrairement à cette image institutionnelle, au niveau national, la Première ministre utilise des tons de plus en plus agressifs et méprisants à l’égard de l’opposition (elle a récemment qualifié la timide solidarité de l’opposition institutionnelle envers la Palestine de « complicité avec le Hamas ») et de ceux qui osent la critiquer. Bien qu’il ait été encore totalement inconnu en Italie, il y a quelques semaines, elle a immédiatement utilisé l’assassinat de Charlie Kirk pour attaquer la gauche, tant modérée qu’extrémiste, allant jusqu’à organiser au Parlement italien une commémoration grotesque de l’activiste réactionnaire pro-Trump.
L’orientation réactionnaire de la droite continue de présider à son action dans le pays. Nous avons déjà évoqué le « décret sécurité ». D’autres mesures ont été prises contre les familles « arc-en-ciel », c’est-à-dire non binaires, empêchant la régularisation des enfants adoptés ou procréés de manière hétérodoxe. Elle a tout fait pour imposer un contrôle strict sur les médias, en particulier sur les télévisions.
La tactique de Giorgia Meloni consiste à utiliser et à essayer d’approfondir au maximum la crise de crédibilité de toute l’opposition dans toutes ses nuances, du centrisme vide de Matteo Renzi à la démagogie résiduelle impuissante du Mouvement 5 étoiles, en passant par l’approche tardive et bancale du PD d’Elly Schlein. Toute l’opposition continue de payer le prix de sa longue et désastreuse saison au gouvernement (des gouvernements « politiques » dirigés par le PD ou le Mouvement 5 étoiles aux gouvernements « techniques » soutenus par le PD, cela a duré de 2011 à 2022), de ses politiques antisociales, de ses réformes institutionnelles perverses, de son soutien aux poussées racistes et sécuritaires, de son appui à la pulvérisation définitive de ce qui était autrefois la cohésion de la classe travailleuse.
Cela se traduit par une diminution progressive, mais inexorable du nombre d’électeur·trices actifs (lors des dernières élections régionales, ce chiffre s’est situé autour de 50 %, voire en dessous), une diminution qui pénalise beaucoup plus l’opposition que les forces de droite au pouvoir. Une analyse intéressante basée sur le pourcentage de votes qui ne s’expriment pas seulement sur une liste, mais sur les préférences pour un·e candidat·e montre que ce pourcentage est beaucoup plus faible dans les votes de droite (surtout pour Fratelli d’Italia), alors qu’il est très élevé pour les formations de l’opposition (parfois, pour le PD, il frôle ou dépasse les 70 %). Ce phénomène témoigne de la capacité de la droite à « parler » aussi à une opinion publique moins organisée et moins liée aux partis, tandis que l’opposition parvient difficilement à attirer les votes de cet électorat non aligné.
Cela suffit à décrire l’impuissance de l’opposition politique et institutionnelle, avec la crise et le déclin du Mouvement 5 étoiles, miraculeusement maintenu en vie, après la mort de Gianroberto Casaleggio et la « trahison » de Beppe Grillo, par la direction de Giuseppe Conte. Le PD est actuellement contraint de faire bonne figure par rapport à la gestion « mouvementiste » d’Elly Schlein, mais continue d’être totalement infesté par une nomenklatura d’administrateurs nostalgiques de Matteo Renzi. Tout cela a favorisé une croissance de l’aile gauche de l’opposition, celle « rouge-verte » de l’AVS de Nicola Fratoianni et Angelo Bonelli, mais c’est une aile qui continue à survivre dans une subordination totale aux autres.

Quant à la « gauche radicale », on aurait envie de ne pas en parler afin de jeter un « voile de piété » sur son « existence ». Il faut toutefois souligner le mouvement récent, ces dernières semaines, pour dénoncer le génocide perpétré à Gaza par Netanyahu et son gouvernement, avec la complicité de nombreux gouvernements (dont celui de l’Italie), ce qui permet un nouveau déploiement des forces en présence. Ce mouvement a marginalisé de manière significative ce qui restait du Parti de la refondation communiste (PRC) et a mis en évidence les ailes les plus ouvertement « campistes » de la gauche radicale italienne, soit le syndicat USB et l’organisation politique Potere al Popolo, qui ont gagné en influence grâce à leur engagement politique et social et à certains choix tactiques judicieux.
Les manifestations qui ont puissamment traversé l’Italie (à l’instar d’autres pays) au cours de l’action de la Global Sumud Flotilla montrent le potentiel persistant qui existe encore dans le pays. Une évaluation politique froide constate qu’il n’y a pas en Italie d’acteurs·trices politiques et sociaux capables d’orienter ce potentiel, si ce n’est dans l’impasse d’un dangereux campisme [aligné sans nuance sur les forces internationales qui s’opposent au « camp occidental », NdT]. Cependant, la nouvelle mobilisation de masse et la nouvelle disponibilité à la militance politique créent de nouveaux espaces de travail politique afin qu’une option internationaliste cohérente puisse contester l’hégémonie de cette orientation dans la gauche radicale.
Pendant ce temps, Giorgia Meloni, avec son pragmatisme tactique, combinant arrogance verbale et modération insinuante, attend que « l’effet Trump » s’étende dans le monde, que d’autres pays européens (la France ? La Grande-Bretagne ? L’Allemagne ?) tombent entre les mains d’autres compagnons d’extrême droite et leur offre un modèle d’action.
* La version originale de cet article est paru en italien, le 21 octobre 2025, sur le site Sinistra anticapitalista. Traduction en français et intertitres supplémentaires de notre rédaction.