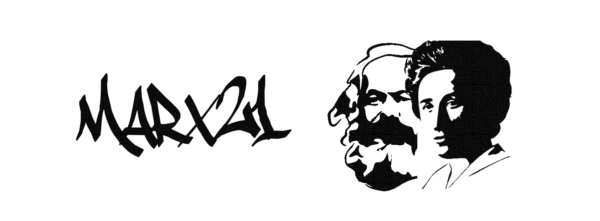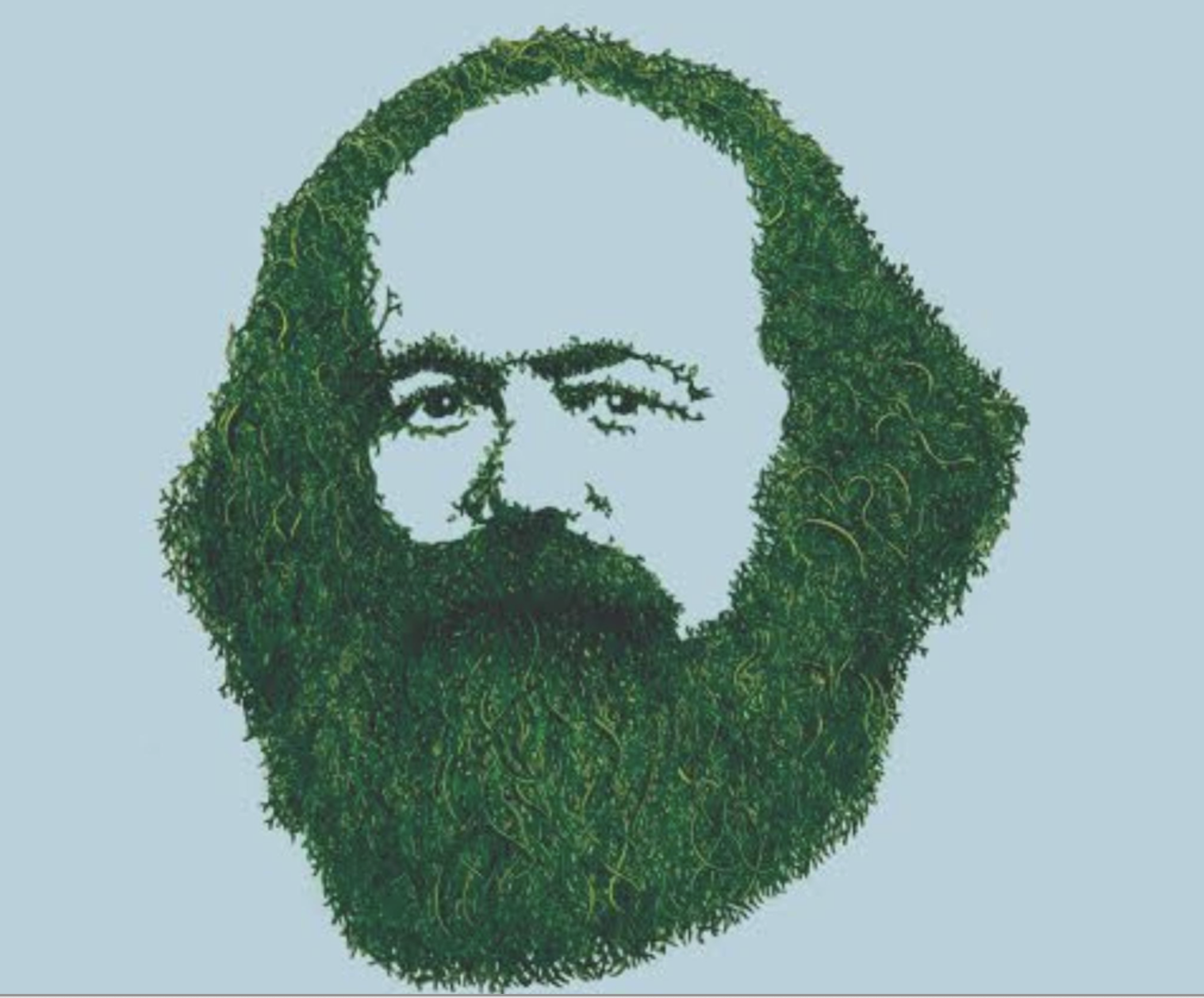La réflexion sur la contribution de Marx à une perspective écologique a beaucoup progressé lors des dernières décennies. L’image un peu caricaturale d’un Marx « prométhéen », productiviste, indifférent aux enjeux de l’environnement, véhiculée par certains écologistes, pressés de « remplacer le paradigme rouge par le vert », a perdu beaucoup de sa crédibilité. Le pionnier dans la redécouverte de la dimension écologique chez Marx et Engels a été sans conteste John Bellamy Foster, avec son ouvrage Marx’s Ecology. Materialism and Nature (2000), qui met en évidence les analyses de Marx sur la « rupture du métabolisme « (Riss des Stoffwechsels) entre les sociétés humaines et l’environnement naturel, provoquée par le capitalisme.
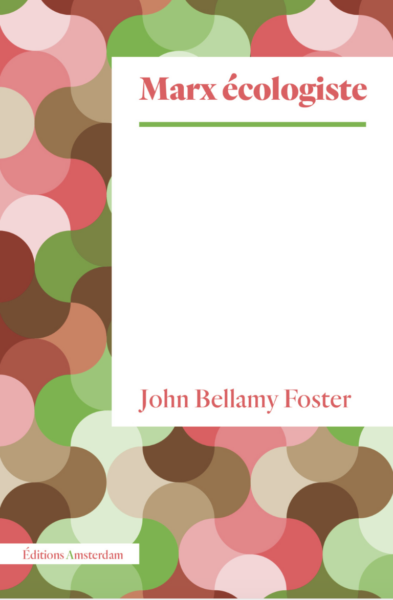
Bellamy Foster a transformé la Monthly Review, une des plus importantes publications de la gauche nord-américaine, en une revue écomarxiste, et a suscité l’essor, autour de la thématique du metabolic rift, de toute une école de pensée marxiste qui inclut des auteurs aussi importants que Brett Clark, Ian Angus, Paul Burkett, Richard York, et plusieurs autres. On peut critiquer Bellamy Foster pour sa lecture de Marx, qui le présente comme un écologiste engagé depuis ses écrits de jeunesse jusqu’à ses derniers travaux, sans prendre en considération des textes ou des passages qui relèvent d’une logique productiviste ; mais on ne peut pas mettre en doute l’importance, la nouveauté, la profondeur de ses travaux. Concernant la lecture de Marx dans une perspective écologique, il y a un axfvant et un après Bellamy Foster.
Marx et l’anthropocène
Proche de cette école de pensée – son premier livre, Karl Marx’s Ecosocialism. Capital, Nature and the Unfinished Critique of Political Economy (2017) fut publié par Monthly Review Press –, le jeune chercheur japonais Kohei Saito se distingue par une interprétation plus nuancée des écrits de Marx. Il montre, aussi bien dans ce premier livre que dans le suivant, Marx in the Anthropocene. Towards the Idea of Degrowth Communism (2022), que la réflexion de Marx sur l’environnement n’est pas un tout homogène. Il ne traite pas les écrits de Marx comme un ensemble systématique d’écrits, défini, du début à la fin, par un fort engagement écologique (selon certains), ou une forte tendance non écologique (selon d’autres), mais comme une pensée en mouvement.

Certes, on peut déceler des éléments de continuité dans la réflexion de Marx sur la nature, mais on y trouve aussi des changements et des réorientations très significatifs. En outre, comme le suggère le sous-titre du livre de 2017 publié en français sous le titre La Nature contre le Capital. L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital (2021), ses réflexions critiques sur la relation entre l’économie politique et l’environnement naturel sont « inachevées ».
Parmi les continuités, l’une des plus importantes est la question de la « séparation » capitaliste des humains de la terre, c’est-à-dire de la nature. Marx pensait que dans les sociétés précapitalistes, il existait une forme d’unité entre les producteurs et la terre, et il considérait que l’une des tâches essentielles du socialisme était de rétablir l’unité originelle entre les humains et la nature, détruite par le capitalisme, mais à un niveau plus élevé (négation de la négation).
Cela explique l’intérêt de Marx pour les communautés précapitalistes, que ce soit dans ses discussions écologiques (par exemple Carl Fraas) ou dans ses recherches anthropologiques (Franz Maurer) : ces deux auteurs étaient perçus comme des « socialistes inconscients ». Et, bien sûr, dans son dernier document important, la lettre à Vera Zassoulitch (1881), Marx affirme que grâce à la suppression du capitalisme, les sociétés modernes pourraient revenir à une forme supérieure d’un type « archaïque » de propriété et de production collectives. Je dirais que cela appartient au moment « anticapitaliste romantique » des réflexions de Marx… Quoi qu’il en soit, cet aperçu intéressant de Saito est très pertinent aujourd’hui, alors que les communautés indigènes des Amériques, du Canada à la Patagonie, sont en première ligne de la résistance à la destruction capitaliste de l’environnement.
Cependant, la principale contribution de Saito est de montrer le mouvement, l’évolution des réflexions de Marx sur la nature, dans un processus d’apprentissage et de remodelage de ses pensées. Avant Le Capital (1867), on peut trouver dans les écrits de Marx une évaluation assez peu critique du « progrès » capitaliste – une attitude souvent décrite par le terme mythologique vague de « prométhéisme ». Cela est évident dans le Manifeste communiste, qui célèbre la « soumission des forces de la nature à l’homme » et le « défrichement de continents entiers pour la culture » ; mais cela s’applique également aux Cahiers de Londres (1851), aux Manuscrits économiques de 1861-1863 et à d’autres écrits de ces années-là.

Curieusement, Saito semble exclure les Grundrisse (1857-1858) de sa critique, une exception qui à mon avis n’est pas justifiée, quand on sait combien Marx admire, dans ce manuscrit, « la grande mission civilisatrice du capitalisme », par rapport à la nature et aux communautés précapitalistes, prisonnières de leur localisme et de leur « idolâtrie de la nature » !
Le changement intervient en 1865-1866, lorsque Marx découvre, en lisant les écrits du chimiste agricole Justus von Liebig, le problème de l’épuisement des sols, et la rupture métabolique entre les sociétés humaines et l’environnement naturel [1]. Cela conduira, dans le Livre I du Capital (1867), mais aussi dans les deux autres volumes inachevés, à une évaluation beaucoup plus critique de la nature destructrice du « progrès » capitaliste, en particulier dans l’agriculture.
Après 1868, en lisant un autre scientifique allemand, Carl Fraas, Marx découvrira également d’autres questions écologiques importantes, telles que la déforestation et le changement climatique local. Selon Saito, si Marx avait pu achever les Livres II et III du Capital, il aurait davantage mis l’accent sur la crise écologique – ce qui signifie aussi, au moins implicitement, que dans leur état actuel d’inachèvement, l’accent n’est pas suffisamment mis sur ces questions…
Cela m’amène à mon principal désaccord avec Saito : dans plusieurs passages du livre, il affirme que pour Marx « la non-durabilité environnementale du capitalisme est la contradiction du système » (p. 142), ou qu’à la fin de sa vie il en est venu à considérer la rupture métabolique comme « le problème le plus grave du capitalisme », ou encore que le conflit avec les limites naturelles est, pour Marx, « la principale contradiction du mode de production capitaliste ». Je me demande où Saito a trouvé, dans les écrits de Marx, les livres publiés, les manuscrits ou les carnets, de telles déclarations…
Elles sont introuvables, et pour une bonne raison : l’insoutenabilité écologique du système capitaliste n’était pas une question décisive au XIXe siècle, comme elle l’est devenue aujourd’hui – ou mieux, depuis 1945, lorsque la planète est entrée dans une nouvelle ère géologique, l’Anthropocène. De plus, je crois que la rupture métabolique, ou le conflit avec les limites naturelles, n’est pas « un problème du capitalisme » ou une « contradiction du système » : c’est bien plus que cela ! C’est une contradiction entre le système et « les conditions naturelles éternelles » (Marx), et donc avec les conditions naturelles de la vie humaine sur la planète. En fait, comme l’affirme Paul Burkett, que Saito cite, le capital peut continuer à s’accumuler dans n’importe quelles conditions naturelles, même dégradées, tant qu’il n’y a pas d’extinction complète de la vie humaine : la civilisation humaine peut disparaître avant que l’accumulation du capital ne devienne impossible…
Saito conclut son livre par une évaluation sobre qui me semble être un résumé très pertinent de la question : Le Capital reste un projet inachevé. Marx n’a pas répondu à toutes les questions ni prédit le monde d’aujourd’hui. Mais sa critique du capitalisme fournit une base théorique extrêmement utile pour la compréhension de la crise écologique actuelle. Par conséquent, j’ajouterais que l’écosocialisme peut s’appuyer sur les idées de Marx, mais qu’il doit développer pleinement une nouvelle confrontation écomarxiste avec les défis de l’Anthropocène au XXIe siècle.
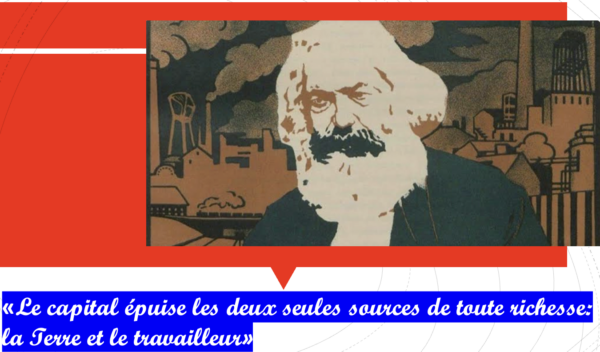
Dans son dernier livre, Marx and the Anthropocene, Saito développe et élargit son analyse des écrits de Marx, en critiquant le productivisme des Grundrisse et de la célèbre Préface à la Contribution à la Critique de l’Economie Politique (1859), souvent considérée comme la formulation définitive du matérialisme historique. Dans la Préface de 1859, les forces productives apparaissent comme la principale force motrice de l’histoire, qui serait libérée, grâce à la révolution, des « entraves » que constituent les relations de production capitalistes.
Saito montre comment, à partir de 1870, dans ses écrits sur la Russie et dans ses cahiers de notes ethnographiques ou naturalistes, Marx va s’éloigner de cette vision de l’histoire. On voit s’esquisser, selon Saito, dans ce « dernier Marx », une nouvelle conception du matérialisme historique – certes inachevée – où l’environnement naturel et les communautés prémodernes (ou non-européennes) jouent un rôle essentiel. Saito tente aussi de montrer, notamment à partir des cahiers de notes récemment publiées par la nouvelle MEGA, une adhésion de Marx à l’idée de décroissance, mais cette hypothèse ne trouve pas un fondement effectif dans ces écrits.
Marx critique de l’accumulation illimitée
Il me semble que la question de la contribution de Marx à l’écosocialisme, ou, si l’on veut, à l’écomarxisme, ne se limite pas à ses textes sur le rapport à la nature – qui restent, il faut le reconnaître, relativement marginaux dans son œuvre : il n’y a pas un seul livre, ou article, ou chapitre de livre, de Marx ou Engels, dédié à l’écologie, ou à la crise écologique. Ce qui est tout à fait compréhensible, considérant que la destruction capitaliste de l’environnement n’était qu’à ses premières manifestations, et n’avait pas du tout la gravité qu’elle a aujourd’hui.
Je pense qu’on trouve dans ses écrits des arguments qui n’ont pas pour objet la nature, mais qui constituent néanmoins des contributions essentielles à une réflexion écomarxiste, à condition d’être repensés en fonction de la crise écologique de notre époque. Deux éléments sont ici à prendre en considération : la critique par Marx de l’hubriscapitaliste, de l’accumulation/expansion sans limites ; le communisme comme « royaume de la liberté ». Examinons-les successivement.
Le capitalisme est un système qui ne peut exister sans une tendance expansive illimitée. Dans les Grundrisse, Marx observe :
Le capital, en tant qu’il représente la forme universelle de la richesse – l’argent – est la tendance sans bornes ni mesure à dépasser sa propre limite. Toute limite ne peut être que bornée pour lui. Sinon, il cesserait d’être capital : l’argent en tant qu’il se produit lui-même. […] Il est le mouvement perpétuel qui tend à toujours en créer plus [2].
C’est une analyse qui sera développée dans le premier volume du Capital. Selon Marx, le capitaliste est un individu qui ne fonctionne que comme « capital personnifié ». À ce titre, il est, nécessairement, un « agent fanatique de l’accumulation », qui « force les hommes, sans merci ni trêve, à produire pour produire ». Ce comportement est « l’effet d’un mécanisme social dont il n’est qu’un rouage ». Quel est donc ce « mécanisme social » dont l’expression psychique chez le capitaliste est « l’avarice la plus sordide et l’esprit de calcul le plus mesquin » ? Voici sa dynamique, selon Marx :
Le développement de la production capitaliste nécessite un agrandissement continu du capital placé dans une entreprise, et la concurrence impose les lois immanentes de la production capitaliste comme lois coercitives externes à chaque capitaliste individuel. Elle ne lui permet pas de conserver son capital sans l’accroître, et il ne peut continuer de l’accroître à moins d’une accumulation progressive [3].
L’accumulation illimitée du capital est donc la règle inflexible du mécanisme social capitaliste : « Accumulez, accumulez ! C’est la loi et les prophètes ! […] Accumuler pour accumuler, produire pour produire, tel est le mot d’ordre de l’économie politique proclamant la mission historique de la période bourgeoise [4]. » Accumulation pour l’accumulation, production pour la production, sans trêve ni merci, sans bornes ni mesure, dans un mouvement perpétuel de croissance, un agrandissement continu : voici, selon Marx, la logique implacable du capital, ce mécanisme social dont les capitalistes ne sont que des « agents fanatiques ». L’impératif d’accumulation devient une sorte de religion séculaire, de culte « fanatique », ou la marchandise remplace « la loi et les prophètes » du judéo-christianisme.

La signification de ce diagnostic pour l’Anthropocène du XXIe siècle est évidente : cette logique productiviste du capitalisme, cette hybris qui exige l’expansion permanente et qui refuse toute limite, est la responsable de la crise écologique et du processus catastrophique de changement climatique de notre époque. L’analyse de Marx permet de comprendre pourquoi le « capitalisme vert » n’est qu’un leurre : le système ne peut pas exister sans accumulation et croissance, une croissance « sans borne ni mesure », qui dépend à 80 % des énergies fossiles.
Voilà pourquoi, malgré les déclarations lénifiantes des gouvernements, et des réunions internationales sur le climat (les COPs), sur la « transition écologique », les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas cessé de croître. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme et mettent en avant la nécessité urgente de cesser toute nouvelle exploitation d’énergies fossiles, en attendant de réduire rapidement l’utilisation des sources existantes ; or les grands monopoles du pétrole ouvrent chaque jour des nouveaux puits, et leur représentant, l’OPEP, annonce publiquement qu’il leur faudra exploiter ces ressources pendant longtemps encore, « pour satisfaire la demande croissante ». Il en va de même pour les nouvelles mines de charbon, qui ne cessent d’être ouvertes, de l’Allemagne « verte » jusqu’à la Chine « socialiste ».
En effet, la demande d’énergie ne fait que croître, et avec elle la consommation des énergies fossiles, les renouvelables venant simplement s’ajouter à celles-ci, plutôt que les remplacer. Si un capitaliste « vert » voulait avoir une pratique différente, il serait évincé du marché : comme le rappelle Marx, « la concurrence impose les lois immanentes de la production capitaliste comme lois coercitives externes à chaque capitaliste individuel ».
La température moyenne de la planète s’est rapprochée dangereusement, en 2023, de la limite de 1,5 degrés au-dessus de la température de l’époque préindustrielle, limite au-delà de laquelle un processus de réchauffement global incontrôlable risque de se déclencher, avec des mécanismes de rétroaction de plus en plus intenses. Les scientifiques du GIEC rappellent la nécessité de réductions immédiates des émissions, les années qui nous séparent de 2030 étant les dernières où il est possible d’éviter la catastrophe.
Or, l’Union Européenne et autres gouvernements annoncent, avec une grande suffisance, qu’ils pourront atteindre le « zéro net » d’émissions… en 2050. Une annonce doublement mystificatrice, non seulement parce qu’elle fait mine d’ignorer l’urgence de la crise, mais aussi parce que « zéro net » est loin d’être identique à « zéro émission » : grâce aux « mécanismes de compensation », les entreprises peuvent continuer leurs émissions, si elles les « compensent » par la protection d’une forêt en Indonésie.

Le capitalisme industriel moderne est totalement dépendant du charbon et du pétrole depuis trois siècles et ne montre aucune disposition à s’en passer. Pour cela, il aurait fallu rompre avec l’accumulation « sans bornes ni mesure », et avec le productivisme, en organisant un processus de décroissance planifiée, avec suppression ou réduction de secteurs entiers de l’économie : une démarche totalement contradictoire avec les fondements même du capitalisme. Greta Thunberg rappelait, à juste titre, qu’il est « mathématiquement impossible de résoudre la crise climatique dans les cadres du système économique existant ». Les analyses de Marx dans Le Capital sur l’inexorable mécanique, « sans trêve ni merci », de l’accumulation/expansion capitaliste, expliquent cette impossibilité.
Beaucoup d’écologistes ont tendance à cibler la consommation comme le responsable de la crise environnementale. Certes, le modèle de consommation du capitalisme moderne est clairement insoutenable. Mais la source du problème se trouve dans le système productif. Le productivisme est le moteur du consumérisme. Marx avait déjà observé cette dynamique. Dans sa Contribution à la critique de l’économie politique (1859), il observe :
La production produit donc la consommation 1. en lui fournissant le matériau ; 2. en déterminant le mode de consommation ; 3. en faisant apparaître chez le consommateur sous la forme de besoin les produits posés d’abord par elle sous la forme d’objet. Elle produit donc l’objet de la consommation, le mode de consommation, l’impulsion à la consommation [5].
C’est beaucoup plus vrai à notre époque qu’au XIXe siècle… Les producteurs capitalistes suscitent « l’impulsion à la consommation » par un vaste, un immense appareil publicitaire, qui martèle, jour et nuit, sur les murs des villes, dans les journaux, dans la radio ou la télévision, partout, « sans trêve ni merci », la nécessité impérative de consommer telle ou telle marchandise. La publicité commerciale s’approprie tous les domaines de la vie : le sport, la religion, la politique, la culture, l’information.
Des besoins artificiels sont créés, des « modes » fabriquées, et le système induit une frénésie consommatrice, « sans bornes ni mesure », de produits de moins en moins utiles, ce qui permet à la production de s’élargir, de s’étendre à l’infini. Si, comme le constate Marx, c’est la production qui produit la consommation, alors c’est le système productif qu’il faut transformer, plutôt que prêcher l’abstinence aux consommateurs. La suppression pure et simple de la publicité commerciale est le premier pas pour dépasser l’aliénation consommatrice et permettre aux individus de retrouver leurs vrais besoins.

Une autre dimension du consumérisme capitaliste critiquée par Marx – une dimension dont les implications écologiques actuelles sont évidentes –, c’est la prédominance de l’avoir sur l’être, de la possession de biens, ou d’argent, ou de capital, sur la libre activité humaine. C’est dans les Manuscrits de 1844 que cette thématique est développée. Selon Marx, dans la société bourgeoisie prédomine, de façon exclusive, « le sens de la possession, de l’avoir ». À la place de la vie des êtres humains apparaît « la vie de la propriété », et « à la place de tous les sens physiques et intellectuels est apparue la simple aliénation de tous ces sens, le sens de l’avoir ». La possession, l’avoir, est une vie aliénée : « Moins tu es, moins tu manifestes ta vie, plus tu possèdes, plus ta vie aliénée grandit, plus tu accumules de ton être aliéné [6]. »
Il s’agit ici d’une autre forme du consumérisme : l’important, ici, ce n’est pas l’usage, mais la possession d’un bien, d’une marchandise. Sa manifestation la plus évidente est la consommation ostentatoire des classes privilégiées, étudiée par Thorstein Veblen dans son classique Théorie de la classe de loisir (1899). Elle atteint de nos jours des proportions monumentales, et nourrit une vaste industrie de produits de luxe : jets privés, yachts, bijoux, œuvres d’art, parfums.
Mais l’obsession possessive gagne aussi d’autres classes sociales, conduisant à l’accumulation de biens comme fin en soi, indépendamment de leur valeur d’usage. L’être, l’activité humaine en tant que telle, est sacrifiée à l’avoir, la possession de marchandises, nourrissant ainsi le productivisme, l’inondation de la vie sociale par une masse grandissante de produits de moins en moins utiles. Bien entendu, les ressources nécessaires à la production de cette montagne de biens marchands sont, encore et de plus en plus, le charbon et le pétrole…
Le communisme, règne de la liberté
Le communisme, en tant que règne de la liberté, est fondé sur la priorité de l’être sur l’avoir, en inversant la logique aliénée imposée par le capitalisme. L’économie politique bourgeoisie pousse jusqu’aux dernières conséquences cette logique perverse : « Le renoncement à soi-même, le renoncement à la vie et à tous les besoins humains est sa thèse principale. Moins tu manges, tu bois, tu achètes des livres, moins tu vas au théâtre, au bal, au cabaret, moins tu penses, tu aimes, tu fais de la théorie, moins tu chantes, tu parles, tu fais de l’escrime, etc., plus tu épargnes, plus tu augmentes ton trésor […] ton capital. […] tout ce que l’économiste te prends de vie et d’humanité, il te le remplace en argent et en richesse [7]. »
Marx inclut dans ce qui constitue l’être – c’est-à-dire la vie et l’humanité des humains – trois éléments constitutifs : I. La satisfaction des besoins essentiels (boire, manger). II. La satisfaction des besoins culturels (aller au théâtre, au cabaret, acheter des livres). Il faut noter qu’il s’agit, pour ces deux catégories, d’actes de consommation vitale, mais pas d’accumulation de biens (tout au plus les livres !) et encore moins celle de l’argent. L’inclusion des besoins culturels est déjà une protestation implicite contre le capitalisme, qui veut limiter la consommation de l’ouvrier à ce qui permet sa survie élémentaire : le boire et le manger. Pour Marx, l’ouvrier, comme tous les êtres humains, a besoin d’aller au théâtre et au cabaret, de lire des livres, de s’éduquer, de s’amuser. III. L’auto-activité humaine : penser, aimer, faire de la théorie, chanter, parler, faire de l’escrime, etc. Cette liste est fascinante, par sa diversité, son caractère à la fois sérieux et ludique, et par le fait qu’elle inclue à la fois l’essentiel – penser, aimer, parler – et le « luxe » : chanter, faire de la théorie, pratiquer l’escrime…
Ce que tous ces exemples ont en commun, c’est leur caractère actif : l’individu ici n’est plus consommateur, mais acteur. Bien entendu, on pourrait ajouter beaucoup d’autres exemples d’auto-activité humaine, individuelle ou collective, artistique ou sportive, ludique ou politique, érotique ou culturelle, mais les exemples choisis par Marx ouvrent une large fenêtre sur le « règne de la liberté ». Certes, la distinction entre ces trois moments n’est pas absolue, manger et lire des livres sont aussi des activités. Il s’agit de trois manifestations de la vie – l’être – face à ce qui est au cœur de la société bourgeoise : l’avoir, la propriété, l’accumulation.
Choisir l’être plutôt que l’avoir est donc une contribution significative de Marx à une culture socialiste/écologique, à une éthique et une anthropologie en rupture avec les données fondamentales de la civilisation capitaliste moderne, où la prédominance absolue de l’avoir, sous sa forme marchande, conduit, avec une frénésie croissante, à la destruction des équilibres écologiques de la planète.
On trouve des réflexions importantes – directement inspirées par les Manuscrits de 1844 – sur l’opposition entre « être » et « avoir » dans les écrits freudo-marxistes du philosophe et psychanalyste Erich Fromm. Juif allemand antifasciste émigré aux USA, Fromm publie en 1976 le livre Avoir ou Être. Un choix dont dépend l’avenir de l’homme, qui compare deux formes opposées d’existence sociale : le mode avoir et le mode être. Dans le premier, ma propriété constitue mon identité : aussi bien le sujet que l’objet sont réifiés (chosifiés). On se ressent soi-même comme une marchandise, et le « ça » possède le « moi ». L’avidité possessive est la passion dominante : or, insiste Fromm, la cupidité, contrairement à la faim, n’a pas de point de satiété, sa satisfaction ne remplit pas le vide intérieur…

Qu’est-ce donc le mode être ? Fromm cite un passage de Marx dans les Manuscrits de 1844 : « Partons de l’idée que l’être humain est un être humain et que sa relation au monde est une relation humaine. L’amour, alors, ne peut être échangé que contre l’amour, la confiance que contre la confiance. » Le mode être, explique Fromm, est un mode actif, ou l’être humain exprime ses facultés, ses talents, la richesse de ses dons ; être actif signifie ici « se renouveler, se développer, déborder, aimer, transcender la prison du moi isolé ; c’est être intéressé, attentif ; c’est donner ». Le mode être est le socialisme, non dans sa version social-démocrate ou soviétique (stalinienne), réduit à une aspiration de consommation maximale, mais selon Marx : auto-activité humaine. Bref, conclut Fromm, citant encore Marx, dans le Livre III du Capital, le socialisme c’est le royaume de la liberté, dont le but est « le développement de la puissance humaine comme fin en soi ».
Karl Marx écrivait rarement sur la société émancipée de l’avenir. Il s’intéressait de près aux utopies, mais se méfiait des versions trop normatives, trop contraignantes, bref, dogmatiques ; son objectif était, comme le rappelle avec pertinence Miguel Abensour, la transcroissance de l’utopie au communisme critique. En quoi consiste celui-ci ? Dans le Livre III du Capital – manuscrit inachevé édité par Friedrich Engels – on trouve un passage essentiel, souvent cité, mais rarement analysé. Le mot « communisme » n’y apparaît pas, mais il s’agit bien de la société sans classes de l’avenir, que Marx définit, et c’est un choix hautement significatif, comme « royaume de la liberté » (Reich der Freiheit) :
Le règne de la liberté commence là ou finit le travail déterminé par le besoin et les fins extérieures : par la nature même des choses, il est en dehors de la sphère de la production matérielle. […] La liberté dans ce domaine ne peut consister qu’en ceci : l’être humain socialisé (vergesellschafte Mensch), les producteurs associés, règlent rationnellement ce métabolisme (Stoffwechsel) avec la nature, le soumettant à leur contrôle collectif, au lieu d’être dominés par lui comme par un aveugle pouvoir ; ils l’accomplissent avec les efforts les plus réduits possibles, dans les conditions les plus dignes de leur nature humaine et les plus adéquates à cette nature. C’est au-delà de ce règne que commence le développement des puissances de l’être humain, qui est à lui-même sa propre fin, qui est le véritable règne de la liberté, mais qui ne peut s’épanouir qu’en s’appuyant sur ce règne de la nécessité. La réduction de la journée de travail est la condition fondamentale [8].
Le contexte où apparaît le passage est intéressant. Il s’agit d’une discussion sur la productivité du travail. L’augmentation de cette productivité permet, suggère l’auteur du Capital, non pas simplement d’élargir la richesse produite, mais surtout de réduire le temps de travail. Celle-ci apparaît donc comme prioritaire par rapport à une extension illimitée de la production de biens.
Marx distingue donc deux domaines de la vie sociale : le « règne de la nécessité » et le « règne de la liberté » : à chacun correspond une forme de liberté. Commençons par examiner de plus près le premier : le règne de la nécessité, qui correspond à la « sphère de la production matérielle » et donc du travail « déterminé par le besoin et des fins extérieures ».
La liberté existe aussi dans cette sphère, mais c’est une liberté limitée, dans le cadre des contraintes imposées par la nécessité : il s’agit du contrôle démocratique, collectif, des êtres humains « socialisés » sur leurs échanges matériels – leur métabolisme – avec la nature. En d’autres termes : ce dont Marx nous parle ici, c’est de la planification démocratique, c’est-à-dire de la proposition essentielle du programme économique socialiste : la liberté signifie ici l’émancipation par rapport au pouvoir aveugle des forces économiques – le marché capitaliste, l’accumulation du capital, le fétichisme de la marchandise.
Revenons au passage ci-dessus du Livre III du Capital : il est intéressant d’observer qu’il n’est pas question, dans ce texte, de la « domination » de la société humaine sur la nature, mais de la maîtrise collective des échanges avec celle-ci : ce qui deviendra, un siècle plus tard, un des principes fondateurs de l’écosocialisme. Le travail reste une activité imposée par la nécessité, en vue de la satisfaction des besoins matériels de la société ; mais il cessera d’être un travail aliéné, indigne de la nature humaine.
La deuxième forme de liberté, la plus radicale, la plus intégrale, celle qui correspond au « royaume de la liberté », se situe au-delà de la sphère de la production matérielle et du travail nécessaire. Il existe cependant entre les deux formes de la liberté un rapport dialectique essentiel : c’est grâce à une planification démocratique de l’ensemble de l’économie qu’on pourra donner une priorité au temps libre ; et, réciproquement, l’extension maximale de ce dernier permettra aux travailleurs de participer activement à la vie politique et à l’autogestion, non seulement des entreprises, mais de toute l’activité économique et sociale, au niveau des quartiers, des villes, des régions, des pays.
Le communisme ne peut pas exister sans une participation de toute la population au processus de discussion et prise de décision démocratique, non pas, comme aujourd’hui, par un vote tous les quatre ou cinq années, mais de manière permanente – ce qui n’empêche pas la délégation de pouvoirs. Grâce au temps libre, les individus pourront prendre en main la gestion de leur vie collective, qui ne sera plus laissée aux mains de politiciens professionnels.

Initiée en 2021, suite à un plan de délocalisation impliquant le licenciement des ouvriers de l’usine de composants automobiles Driveline GKN, située dans la banlieue de Florence en Italie, cette lutte a donné lieu à l’occupation de l’usine, à l’élaboration d’un plan de reconversion écologique par les travailleurs avec l’aide du groupe de solidarité Insorgiamo con i lavoratori GKN (Nous nous insurgeons avec les ouvriers de GKN) et un collectif de chercheurs militants.
Ce que Marx ajoute à son argument de 1844, dans le Livre III du Capital, c’est le fait que l’auto-activité humaine – le troisième moment dont il est question dans les Manuscrits économico-philosophiques – exige, pour pouvoir s’épanouir, du temps libre, du temps obtenu par la réduction des heures de travail « nécessaire ». Cette réduction est donc la clé qui ouvre la porte vers le « royaume de la liberté », qui est aussi le « royaume de l’être ». Grâce à ce temps de liberté, les humains pourront effectivement développer leurs potentialités intellectuelles, artistiques, érotiques, ludiques. Nous sommes ici à l’opposé de l’univers capitaliste de l’accumulation à l’infini de marchandises de moins en moins utiles, de l’« expansion » productiviste et consumériste sans limite et sans mesure.
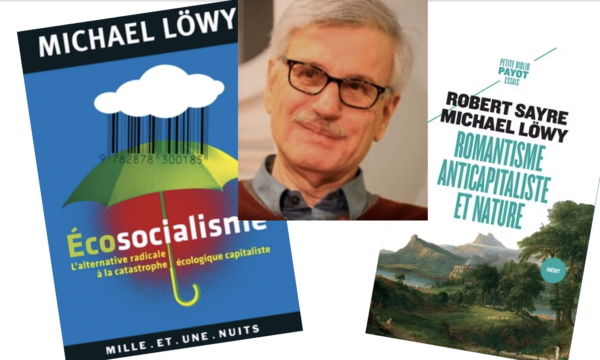
Conclusion
Au-delà de ses écrits qui se réfèrent directement à la nature, et à sa destruction par le « progrès » capitaliste, l’œuvre de Marx contient des réflexions qui ont, au niveau le plus profond, une signification écologique, par leur critique du productivisme capitaliste et par leur imagination d’une société où c’est la libre activité humaine qui est au centre de la vie sociale, et non l’accumulation obsessive de « biens ». Ce sont des repères essentiels pour le développement d’un écomarxisme du XXIe siècle.
* Cet article est paru dans la revue Actuel Marx, n°76, 2024 (2), p. 13-14. Nous le republions avec l’autorisation de l’auteur.
Michael Löwy, sociologue franco-brésilien. Directeur de recherche émérite au CNRS. Coauteur, avec Joel Kovel, du Manifeste écosocialiste international (2001). Ses écrits ont été traduits en trente-deux langues. Parmi ses livres : Écosocialisme. Une alternative radicale au désastre écologique capitaliste, Paris, Mille et une nuits, 2020 ; Romantisme anticapitaliste et nature, Paris, Payot, 2022 (avec Robert Sayre).