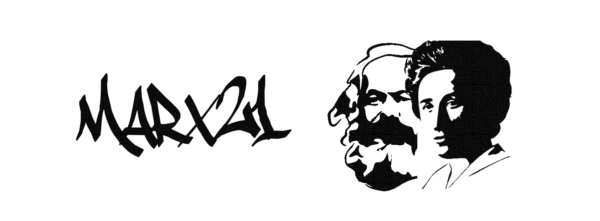Dans cet article, je m’intéresse à la généalogie de l’« intersectionnalité ». Plus précisément, je m’intéresse à l’histoire de la conceptualisation de la « diversité » comme étant constituée de l’interaction de multiples « types » de différences sociales », par exemple, la race, la classe sociale, le genre, etc. [1] L’« intersectionnalité » n’est en réalité que l’un des nombreux concepts séduisants, mais imparfaits, utilisés depuis plus de 80 ans pour représenter l’hétérogénéité de la société. Je conclus en proposant quelques suggestions afin de développer une approche plus adéquate pour conceptualiser la « diversité ».
Notre site contient une série d’articles sur l’intersectionnalité, à découvrir ici
Le discours standard
Les universitaires féministes noires ont inventé la notion d’« intersectionnalité » à la fin des années 1980. Celle-ci est ensuite devenue la façon dominante de conceptualiser la « diversité » dans le milieu universitaire et au-delà. Voici, tirée de Wikipédia, une présentation typique de cette notion :
« L’intersectionnalité (ou théorie intersectionnelle) est un terme inventé en 1989 par Kimberlé Williams Crenshaw, militante américaine des droits civiques et éminente spécialiste de la théorie critique de la race. Il s’agit de l’étude des identités sociales qui se chevauchent ou s’entrecroisent et des systèmes d’oppression, de domination ou de discrimination qui y sont associés. L’intersectionnalité est l’idée que plusieurs identités s’entrecroisent pour créer un tout qui est différent des identités qui le composent. Ces identités qui peuvent s’entrecroiser comprennent le genre, la race, la classe sociale, l’ethnicité, la nationalité, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, le handicap mental, le handicap physique, la maladie mentale et la maladie physique, ainsi que d’autres formes d’identité. Ces aspects de l’identité ne sont pas « des entités unitaires et mutuellement exclusives, mais plutôt… des phénomènes qui se construisent mutuellement ». La théorie propose de considérer chaque élément ou trait d’une personne comme inextricablement lié à tous les autres éléments afin de comprendre pleinement son identité.
Ce cadre peut être utilisé pour comprendre comment l’injustice systémique et les inégalités sociales se manifestent de manière multidimensionnelle. L’intersectionnalité soutient que les conceptualisations classiques de l’oppression au sein de la société — telles le racisme, le sexisme, le classisme, le validisme, l’homophobie, la transphobie, la xénophobie et le fanatisme religieux — n’agissent pas indépendamment les unes des autres. Au contraire, ces formes d’oppression sont interdépendantes, créant un système d’oppression qui reflète l’« intersection » de multiples formes de discrimination. (« Intersectionnalité », 2017, consulté le 4 mars 2017.)
Ainsi, le cadre intersectionnel serait capable de traiter à la fois les questions d’identité personnelle et les questions structurelles de privilège, d’oppression et de justice.
Le concept d’intersectionnalité a été inventé dans le contexte de l’expansion massive d’un nouveau domaine universitaire, les études féminines. Au fil du temps, un récit quelque peu mythologique du développement de la deuxième vague du féminisme s’est imposé comme norme. Selon ce récit, le féminisme de la deuxième vague est apparu dans les années 1960 et 1970 comme un phénomène monolithique de la classe moyenne blanche qui ignorait les questions de race et de classe.

Ce n’est que dans les années 1980, selon ce mythe, que les choses ont changé, lorsque les femmes noires sont entrées à l’université et ont remis en question avec force le féminisme dominé par les Blanches. Les universitaires féministes afro-américaines — par exemple, Kimberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins, bell hooks et bien d’autres — ont pris l’initiative d’introduire la question de la race dans l’analyse féministe. Dans certains cas, elles ont également abordé la question de la classe sociale. Leur leadership, durement acquis sous la bannière de l’« intersectionnalité », a finalement permis de rompre avec les erreurs du féminisme dit « blanc ».
Dans les années 1980 et après, ce récit chronologiquement confus est devenu hégémonique parmi les féministes blanches comme noires, même celles qui auraient dû être mieux informées. Mais il est profondément problématique. Tout d’abord, il simplifie l’histoire de l’évolution très complexe du féminisme de la deuxième vague, qui s’est développé selon plusieurs courants, et pas uniquement au sein du monde universitaire. En réalité, comme je l’explique plus loin, les féministes socialistes et marxistes [2] ont toujours prêté attention à la question des classes sociales ; comment auraient-elles pu faire autrement ? La question raciale jouait également souvent un rôle dans leurs analyses.
Il y a également ici un enjeu méthodologique : l’histoire est toujours complexe et comporte de multiples facettes, et nous devons nous méfier des récits simplistes. Un récit peut être hégémonique sans pour autant réduire au silence les voix alternatives. De même, un récit hégémonique, à un moment donné, peut perdre sa position dominante à un autre moment. C’est ce qui s’est produit, je pense, pour les analyses féministes socialistes au cours des décennies qui ont précédé l’apogée de l’intersectionnalité.
Un autre problème avec le récit standard est qu’il peut nous aveugler sur les faits historiques qui contredisent cette histoire. En d’autres termes, il fonctionne comme un paradigme kuhnien [de Thomas S. Kuhn, soit un cadre intellectuel partagé, NDT] , menaçant de rendre invisibles toutes les données qui ne correspondent pas au récit standard. Je l’appellerai le paradigme du « féminisme blanc ». Comme tous les paradigmes, il a une certaine validité, mais, dans l’ensemble, il déforme l’histoire, avec des conséquences dommageables.
Le récit historique
Que s’est-il donc « réellement » passé ? Et pourquoi est-il important de corriger le récit historique ? [3] Pour répondre à ces questions, nous devons remonter avant les années 1980, jusqu’aux années 1960, voire avant. Dans les années 1960 et 1970, l’activisme et les analyses socialistes-féministes ont joué un rôle important dans le mouvement féministe naissant. De nombreuses féministes socialistes affirmaient que trois systèmes (ou paramètres de différences, ou autres) — la race, la classe et le genre — interagissaient dans la vie des gens, qu’ils en soient conscients ou non. Ces systèmes étaient généralement considérés comme interagissant simultanément et inextricablement, liés dans une matrice de privilèges et de domination.

Il y avait aussi l’implication que la race, la classe sociale et le genre sont des phénomènes en quelque sorte comparables, et d’égale importance. En partant du principe que les différentes dimensions du « cadre race/classe/genre » étaient comparables, voire équivalentes, les féministes socialistes faisaient une déclaration politique importante à l’époque : aucun des trois éléments de la trilogie ne pouvait être considéré comme prioritaire. Ainsi, la réflexion sur la race, la classe et le genre chez les féministes socialistes pouvait se distinguer politiquement et analytiquement du féminisme radical (qui accordait la priorité au genre), d’une part, et du socialisme traditionnel (qui accordait généralement la priorité à la classe), d’autre part. Dans une période d’activisme intense, cette position politique avait une audience large.
La race, la classe sociale et le genre sont rapidement devenus un mantra, un ensemble de facteurs à toujours prendre en compte et à codifier dans les slogans politiques, les prises de position, les listes de revendications, etc. Et dans la mesure où le féminisme s’est solidement implanté dans le monde universitaire au cours des années 1970 et après, la race, la classe sociale et le genre ont dû être reflétés dans les articles, les revues, les titres, les programmes et les manuels scolaires. En tant que cadre d’analyse et d’action politique, la race/classe/genre — également connu sous le nom de « trilogie » — semblait être nouvelle et puissante.
En d’autres termes, la réflexion sur la race, la classe et le genre n’est pas née des activités des universitaires féministes noires dans les années 1980. Elle a plutôt émergé parallèlement aux mouvements féministes et autres mouvements sociaux des années 1960 et du début des années 1970. En effet, bon nombre de pionnières du mouvement de libération des femmes avaient elles-mêmes participé aux mouvements pour les droits civiques, la libération des Noirs et contre la guerre.
Mon propre parcours en est un exemple : en 1964 et 1965, j’avais travaillé avec le Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) dans le Mississippi ; dans le Nord, j’avais soutenu le mouvement contre la guerre et j’avais rejoint avec enthousiasme le mouvement de libération des femmes, lorsqu’il a vu le jour, à la fin des années 1960. Il n’est donc pas surprenant que j’aie utilisé le modèle race/classe/genre dans mes deux premiers articles féministes (Vogel, 1971 ; 1974).

Au fil du temps, le cadre analytique race/classe/genre s’est élargi pour inclure d’autres facteurs pouvant jouer un rôle dans les privilèges ou l’oppression : l’ethnicité, la sexualité, la géographie, la religion, la culture, l’identité de genre, le handicap, etc. De manière quelque peu embarrassante, le cadre race/classe/genre commençait à ressembler à une liste à la Prévert. De plus, plus le nombre de facteurs cités augmentait, plus il fallait examiner d’interactions, ce qui posait de sérieux problèmes de raisonnement.
Dans les années 1980, bon nombre des mouvements sociaux contestataires des décennies précédentes ont fait l’objet de diverses formes d’attaques, y compris une répression violente. Pourtant, le mouvement de libération des femmes, désormais appelé féminisme, a survécu et s’est même développé. Et parmi les nouvelles générations d’étudiant·es et d’universitaires qui ont intégré le monde académique dans les années 1980 et après, beaucoup n’avaient jamais participé à un mouvement social ni réfléchi au phénomène de la « diversité ». C’est, à mon avis, ce qui a conduit à une réécriture de l’histoire des années 1960, d’abord par les médias, puis par les universitaires féministes elles-mêmes. Il devait être tellement plus excitant d’inscrire les tournants historiques les plus importants en utilisant sa propre chronologie.
Comment sommes-nous passés du concept extrêmement populaire de race/classe/genre à celui, tout aussi populaire, d’intersectionnalité ? Pourquoi un mantra en a-t-il remplacé un autre ? À mon avis, ce n’est pas seulement dû aux interventions de Crenshaw et d’autres universitaires noirs, aussi importantes fussent-elles. C’est le contexte dans lequel elles ont eu lieu qui a joué un rôle déterminant. Quelque chose dans ce contexte a dû rendre l’intersectionnalité particulièrement attrayante et la race/classe/genre moins attrayante (voir également la note 1 ci-dessus).
Peut-être que l’intersectionnalité, tout comme la « diversité », semblait mieux à même d’englober tous les aspects de manière accessible et nuancée, tout en préservant l’autonomie des systèmes spécifiques dans l’unité que représentait l’intersectionnalité. En revanche, la race/classe/genre, et plus encore la liste exhaustive, pouvaient sembler trop lourds, trop affirmés, à l’ère du postmodernisme et de la déconstruction.
Une autre caractéristique attrayante de l’intersectionnalité par rapport à la race/classe/genre est qu’elle élude les mots puissants que sont race et classe, qui évoquent non seulement l’oppression, mais aussi la violence et le chaos, et qui impliquent implicitement la justice sociale et le changement structurel. Il valait mieux obscurcir leur signification pendant ces décennies conservatrices. Je pense aux sources de financement, aux comités de titularisation, etc., ainsi qu’aux jeunes chercheuses qui cherchaient à trouver leur place dans le monde universitaire. [souligné par Marx.21.ch]
Origines
Jusqu’à présent, j’ai soutenu que la conceptualisation de la « diversité » en termes de race/classe/genre était courante parmi les féministes de gauche dans les années 1960 et 1970. Mais d’où venait-elle ? A-t-elle été inventée, comme d’autres concepts de la libération des femmes — par exemple, « sexisme », « féminicide » et « Ms » [acronyme neutre qui ne renvoie pas à l’état civil d’une femme, NDT] ? Ou le mouvement de libération des femmes en a-t-il hérité ?
Je pense qu’il est très probable que la conceptualisation race/classe/genre, qui est devenue populaire dans les années 1960, provienne d’une tradition centenaire, transmise par l’expérience vécue et le militantisme des femmes afro-américaines. J’ai trouvé des preuves de cette hypothèse dans les travaux et les écrits de Maria Miller Stewart [1803-1879], Sojourner Truth [1797-1883], Anna Julia Cooper [1858-1964], Mary Church Terrell [1863-1954], Pauli Murray [1910-1985] et d’autres.

Ces militantes, souvent citées par les auteures qui traitent de l’intersectionnalité, qui les jugent intéressantes, mais sans liens précurseurs par rapport à elles — auraient en fait pu être les porteuses d’une traditions féministe noire vivante, qui a été par la suite reprise par l’article de Fran Beal, publié en 1969, sur la « double incrimination » [être noir et femme, NDT], dans la déclaration du Combahee River Collective de 1977, dans l’article de Kimberlé Crenshaw sur l’intersectionnalité, publié en 1989, etc. (Beal, 1970 ; Combahee River Collective, 1977 ; Crenshaw, 1989).
Les femmes noires et blanches actives au sein du Parti communiste américain ont certainement joué un rôle important dans cette transmission. Selon l’historienne Kate Weigand, dans les années 1930 et 1940, « les publications communistes utilisaient régulièrement les termes “triple fardeau” et “triple oppression” pour décrire la situation des femmes noires » (Weigand, 2001, 99 ; voir également McDuffie, 2011). D’autres termes incluaient « triple exploitation » et « double emploi ». Claudia Jones, éminente dirigeante noire du PC des États-Unis et du Congrès des femmes américaines, était peut-être la principale représentante de la pensée race/classe/genre avant les années 1960 (Boyce Davies, 2008, 2011 ; Lynn, 2014).

« La bourgeoisie a peur du militantisme de la femme Noire, et elle a de bonnes raisons d’avoir peur. Les capitalistes savent, mieux que de nombreux progressistes, qu’une fois que les femmes Noires commencent à prendre des mesures, le militantisme de tout le peuple noir, et donc de la coalition anti-impérialiste, est grandement améliorée.
Historiquement, les femmes Noires ont été les gardiennes, les protectrices, de la famille Noire… En tant que mère, que Noire, et que travailleuse, la femme noire se bat contre l’éradication de la famille des Noires, contre l’existence des ghettos de Jim Crow qui détruisent la santé, le moral et de nombreuses vies de ses sœurs, frères et enfants.
Vu sous cet angle, ce n’est pas par hasard que la bourgeoisie américaine a intensifié son oppression, pas seulement contre le peuple Noir en général, mais contre les femmes Noires en particulier. Rien n’est autant exposé à la volonté de fascisation (sic) dans la nation que l’attitude impitoyable que la bourgeoisie affiche et cultive envers les femmes Noires. » (extrait de An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman! 1949) [cette citation de figure pas dans l’article de Lise Vogel]
D’après ma propre expérience, en tant que militante et universitaire marxiste-féministe en herbe, dans les années 1960 [4], le cadre analytique race/classe/genre me semblait familier et immédiatement accessible. Je n’avais pas besoin d’y réfléchir profondément, et encore moins de l’inventer. Avais-je hérité ce cadre de mes parents de gauche [son père, Sidney Vogel, avait servi comme médecin volontaire antifranquiste en Espagne, pendant la guerre civile espagnole, de 1977 à 1939, NDT] ?
En bref, les féministes noires ont eu raison de reconnaître Crenshaw et d’autres universitaires noires comme les cheffes de file de l’effort visant à mettre en avant l’intersectionnalité dans les années 1980, mais elles ont manqué l’occasion d’ancrer plus profondément leur contribution dans le contexte historique de la vie des femmes noires.
Les non-historien·nes pourraient se demander pourquoi il est important de bien comprendre le passé. Peut-être suis-je simplement trop pointilleuse ? Je pense que cela importe avant tout en raison de ce que nous perdons de vue, lorsque nous comprenons mal l’histoire. Comme je l’ai déjà mentionné, nous passons à côté de beaucoup de choses lorsque nous adhérons au paradigme du « féminisme blanc ». Nous négligeons l’importance des nombreuses militantes noires qui, pendant plus d’un siècle, ont forgé une tradition de résistance. Nous négligeons le rôle du Parti communiste américain et du Congrès des femmes américaines. Nous minimisons les contributions des militantes et des écrivaines communistes et de gauche, qu’elles soient blanches ou noires.
D’autres histoires ont été également effacées par le paradigme du « féminisme blanc ». Il nous fait oublier que certaines des femmes blanches qui ont participé activement aux mouvements de libération des Noirs dans les années 1960 ont également pris part à la création du mouvement de libération des femmes. De plus, le leadership exercé par des femmes noires, telles que Pat Robinson — qui a fondé, en 1960, le groupe de femmes Mount Vernon/New Rochelle, lequel a attiré un large éventail de femmes noires issues de la classe ouvrière — disparaît. Le paradigme de la « féministe blanche » marginalise encore davantage l’importance du militantisme autour des droits sociaux, qui était un enjeu et un mouvement féministes et de classe sociale, qui a également commencé bien avant l’apogée de la deuxième vague du féminisme.

Sans avoir accès à l’ensemble du contexte historique des années 1960 et des années précédentes, nous nous retrouvons avec un récit troublant d’hostilité entre les universitaires féministes noires et blanches, qui a soudainement émergé dans les années 1980. Nous pouvons faire mieux.
Modèles et prismes
Enfin, permettez-moi de vous faire part de quelques réflexions sur l’utilité de concepts, tels que race, classe sociale, genre et intersectionnalité. Je les considère comme principalement descriptifs. En d’autres termes, ils fournissent un cadre conceptuel pour décrire et étudier la « diversité », mais ne fournissent en eux-mêmes aucune explication. À strictement parler, ils sont donc imprécis et on pourrait même s’opposer à leur utilisation.
Néanmoins, je pense que ces concepts peuvent encore être utiles en première approximation. Ils offrent un moyen attrayant, bien qu’inadéquat, de parler des relations entre les multiples « dimensions de la différence », telles que la race, la classe sociale et le genre. Et pour celles et ceux qui découvrent ces questions, ils peuvent servir de mécanismes de sensibilisation.
Par exemple, un projet du Center for Victims of Torture, basé dans le Minnesota, aborde l’intersectionnalité comme un moyen d’aller « au-delà des questions individuelles et de la politique identitaire ». Plus précisément, « l’intersectionnalité est à la fois un prisme permettant de voir le monde de l’oppression et un outil pour l’éradiquer ». Le projet présente également des études de cas de tactiques efficaces en matière de droits humains, développées et déployées à l’aide de cette « boîte à outils stratégique » [5]. Je ne voudrais pas être celle qui reproche à ces militantes d’utiliser un concept incorrect.

À long terme, les efforts marxistes-féministes pour conceptualiser la « diversité » nécessitent plus qu’une nouvelle métaphore ou un nouveau mot à la mode (Davis, 2008). Un demi-siècle après que les féministes socialistes ont commencé à réfléchir à ces questions, nous vivons dans un paysage politique et théorique transformé. Relativement peu de féministes s’identifieraient aujourd’hui au féminisme socialiste, encore moins se considéreraient-elles comme des féministes marxistes, sauf celles qui ont accès à un discours marxiste international vivant, complètement absent auparavant.
Je pense, qu’à ce stade, nous pouvons dépasser certaines des conceptualisations antérieures. Je commencerais par rejeter l’hypothèse selon laquelle les différentes dimensions de la différence — par exemple, la race, la classe sociale et le genre — sont comparables. Bon gré mal gré, cette hypothèse de comparabilité conduit à s’intéresser à l’identification des parallèles et des similitudes entre les catégories de différence, et à minimiser leurs particularités. De même, elle peut suggérer que les différentes catégories ont un poids causal égal.
Une fois que nous avons abandonné le modèle de comparabilité, nous pouvons sortir du petit cercle restreint de catégories supposées similaires. Notre tâche théorique consiste alors à nous concentrer sur les spécificités de chaque dimension et à développer une compréhension de la manière dont tout cela s’articule — ou ne s’articule pas — ensemble. Ce processus pourrait déboucher sur une ou plusieurs perspectives permettant d’analyser les données empiriques [6].
En matière de réflexion sur les classes sociales, nous disposons d’une littérature abondante, qui remonte à Marx lui-même. Traditionnellement, cette littérature ignorait les questions de genre et de race, partant du principe que la classe sociale était la dimension fondamentale. Plus récemment, des progrès ont été réalisés dans la reconnaissance du rôle distinct de la classe sociale, sans pour autant rejeter entièrement les autres dimensions.
Martha Gimenez (2005 ; 2018), par exemple, a longtemps défendu que la fameuse trilogie devait être écartée, souhaitant la remplacer par un « retour à la classe, reconnaissant la nature de classe de la société américaine et les relations d’oppression qui la fragmentent ». Écrivant dans une perspective de sciences politiques, Victor Wallis (2015, 604) a exploré « la distinction structurelle entre la domination de classe et les structures intersectionnelles d’oppression définies par la race, le genre, la sexualité ou d’autres critères. » En d’autres termes, il devient possible, voire acceptable, de reconnaître la classe comme un facteur clé tout en intégrant l’analyse d’autres facteurs.
Pour le genre, le point de départ pourrait être la « théorie de la reproduction sociale », une nouvelle perspective, encore en cours d’élaboration. Mon livre Le marxisme et l’oppression des femmes. Vers une théorie unitaire (1983, 2013) [paru en français en 2022] a été qualifié de fondement de la théorie de la reproduction sociale [7]. Dans ce qui suit, j’esquisse certains des éléments de cette théorie, tels que je les comprends.

Le terme « reproduction sociale » vient bien sûr de Marx, mais aussi de ma perception de la « perspective de la reproduction sociale », que j’ai opposée à la « perspective des systèmes doubles » (Vogel, 2013, 133-136, et passim). La théorie de la reproduction sociale est censée offrir une vision « unitaire » de l’oppression des femmes. Le mot « unitaire » n’apparaît que dans le sous-titre du livre (Vers une théorie unitaire) ; il est totalement absent du texte. Néanmoins, mes collègues ont été convaincus que son caractère « unitaire » est une caractéristique significative de la reproduction sociale.
Théorie de la reproduction. Je soupçonne qu’ils s’y accrochent pour deux raisons. Premièrement, elle marque un rejet définitif de la théorie des deux systèmes qui a dominé pendant si longtemps la pensée socialiste et féministe. Ensuite, elle promet une solution théoriquement unifiée. Comme l’explique Tithi Bhattacharya (2013), « l’idée la plus importante de la théorie de la reproduction sociale est que le capitalisme est un système unitaire capable d’intégrer avec succès, bien que de manière inégale, la sphère de la reproduction et la sphère de la production. Les changements dans une sphère ont donc des répercussions dans l’autre ».
Ferguson et McNally (2013, xxiii) soulignent l’originalité de l’ouvrage dans sa lecture de Marx :
« Plutôt que de greffer une analyse matérialiste de l’oppression sexuelle sur l’analyse marxiste du capitalisme — et de tomber dans l’éclectisme méthodologique qui afflige la théorie des deux systèmes — Vogel propose d’étendre et d’élargir la portée conceptuelle des catégories clés du Capital afin d’expliquer rigoureusement les racines de l’oppression des femmes… [Elle] explore les lacunes théoriques du Capital, les passages où le texte reste largement muet [et] pousse ainsi les innovations conceptuelles du Capital vers des conclusions logiques qui ont échappé à son auteur et à des générations de lecteurs. »
La force de la théorie de la reproduction sociale réside, selon moi, dans le fait qu’elle théorise la vie des femmes issues de la classe travailleuse dans le cadre du processus global d’accumulation capitaliste. Oui, la « classe » — ou plutôt le processus d’accumulation capitaliste — est un élément clé, mais tant que le capitalisme dépend de la force de travail des êtres humains, la « classe » et le « genre » ont des fondements matérialistes et sont intimement liés.
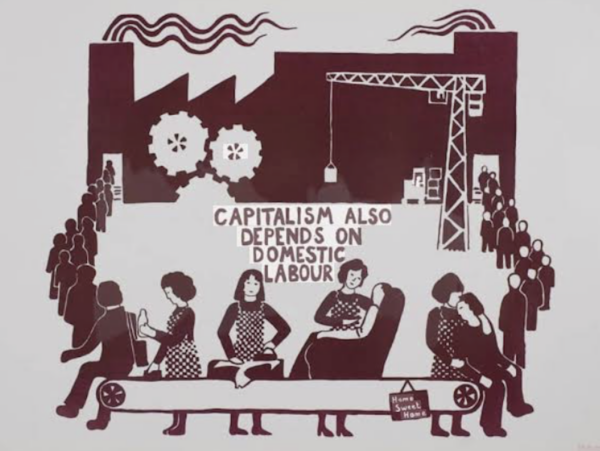
Ce n’est pas le cas de la « race ». La « race » m’a toujours semblé être l’élément le plus problématique des éléments de la « trilogie ». Là, je pense que nous devons commencer par nous référer à Barbara Fields et à son analyse de la race comme idéologie dans contexte US.
« L’idéologie raciale a fourni les moyens d’expliquer l’esclavage à des personnes dont le terrain était une république fondée sur des doctrines radicales de liberté et de droits naturels et, plus important encore, une république dans laquelle ces doctrines semblaient représenter fidèlement le monde dans lequel tous vivaient, sauf une minorité. Ce n’est que lorsque le déni de liberté est devenu une anomalie apparente, même pour les membres les moins observateurs et les moins réfléchis de la société euro-américaine, que l’idéologie a systématiquement expliqué cette anomalie. La race justifiait pourquoi certaines personnes pouvaient à juste titre être privées de ce que d’autres considéraient comme acquis : à savoir la liberté, supposée être un don évident du Dieu nature. » (Fields, 1990, 114.)
Dire que la « race » est idéologique ne signifie pas qu’elle ne soit pas réelle — en fait, elle est puissamment réelle, comme l’ont démontré les historiens et comme nous le constatons chaque jour aux États-Unis.
Cette discussion révèle d’une autre façon pourquoi la notion d’une trilogie de facteurs comparables n’est pas satisfaisante. La race, la classe et le genre ne sont en aucun cas comparables sur le plan ontologique. Le terme « classe » est un indicateur abrégé qui renvoie au domaine de l’accumulation capitaliste, où la force de travail est consommée et où la plus-value est produite. Dans la mesure où les processus biologiques contribuent à la reproduction de la force de travail, le « genre » recoupe la « classe », mais n’est pas logiquement nécessaire à celle-ci [8]. La « classe » et le « genre » peuvent tous deux être analysés de manière abstraite, comme faisant partie du système d’accumulation capitaliste compris au niveau théorique. Mais la « race » s’en distingue — elle est plus évidente et au moins aussi préjudiciable dans notre vie quotidienne, je pense — que la classe ou le genre.
* Cet article est paru en 2018 dans Science & Society, vol. 82, n° 2 (avril 2018), p. 275-287, sous le titre : « Beyond Intersectionality » https://www.jstor.org/stable/26571438 Notre traduction.
Lise Vogel est l’auteure de Le marxisme et l’oppression des femmes. Vers une théorie unitaire, Paris, éditions sociales, [1983] 2022.
Références
Ahmed, Sara. 2012. On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life. Durham, Caroline du Nord : Duke University Press.
Beal, Frances M. 1970. « Double Jeopardy: To Be Black and Female ». Révisé à partir d’une brochure de 1969. Dans Sisterhood is Powerful. éd. Robin Morgan. New York: Vintage Books.
Benn Michaels, Walter. 2006. The Trouble with Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality. New York: Metropolitan Books.
Bhattacharya, Tithi. 2013. “What is Social Reproduction Theory?” https:// socialist-worker.org/2013/09/10/what-is-social-reproduction-theory
—2015. “How Not To Skip Class: Social Reproduction of Labor and the Global Working Class”. Viewpoint Magazine.https://www.viewpointmag.com/ 2015/10/31/ how-not-to-skip-class-social-reproduction-of-labor-and-the-global-working-class
Boyce Davies, Carole. 2008. Left of Karl Marx: The Political Life of Black Communist Claudia Jones. Durham, Caroline du Nord : Duke University Press.
–, éd. 2011. Claudia Jones : Beyond Containment. Banbury, Oxfordshire, Angleterre : Ayebia Clarke Publishing.
Cabrera, Nolan L. 2008. Review of The Trouble with Diversity, par Walter Benn Michaels. InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies, 4:1.
Collins, Patricia Hill et Sirma Bilge. 2016. Intersectionality. Cambridge, Angleterre : Polity Press.
Combahee River Collective. 1995 (1977). “A Black Feminist Statement.” In Words of Fire: An Anthology of African-American Feminist Thought, ed. Beverly Guy-Sheftall. New York: The New Press.
Crenshaw, Kimberlé. 1989. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Discrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Practice”. University of Chicago Legal Forum, 89, 139–167.
Davis, Kathy. 2008. “Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science Perspective on What Makes a Feminist Theory Successful”. Feminist Theory, 9:1, 67–85.
Evans, Sara M. 2015. « Women’s Liberation: Seeing the Revolution Clearly ». Feminist Studies, 41:1, 138–149.
Ferguson, Susan, et David McNally. 2013. “Capital, Labour-Power, and Gender Relations: introduction to the HM edition of Marxism and the Oppression of Women, in Vogel, 2013.
Fields, Barbara J. 1990. “Slavery, Race and Ideology in the United States of America, New Left Review, 181 (mai-juin), 95–118.
Giardina, Carol. 2010. Freedom for Women. Forging the Women’s Liberation Movement, 1953–1970. Gainesville, Floride. The University Press of Florida.
Gimenez, Martha. 2001. “Marxism and Class, Gender and Race: Rethinking the Trilogy”, Race, Gender & Class, 8:2, 22–33.
—. 2018 (à paraître). “Intersectionnaly: Marxist Critical Observations. ”. Science & Society, 82:2 (avril).
“Intersectionality”. 2017. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/ wiki/Intersectionality. Accessed March 4, 2017.
James, Marlon. 2016. “Why I’m Done Talking About Diversity. Or, Why We Should Try an All-White Diversity Panel.” http://lithub.com/marlon-james-why-im-done talking-about-diversity
Lynn, Denise. 2014. “Socialist Feminism and Triple Oppression: Claudia Jones and African American Women in American Communism.” Journal for the Study of Radicalism, 8:2 (Automne), 1–20.
McDuffie, Erik S. 2011. Sojourning for Freedom: Black Women, American Communism, and the Making of Black Left Feminism. Durham, North Carolina: Duke University Press.
Taylor, Keeanga-Yamahtta, éd. 2017. How We Get Free: Black Feminism and the Combahee River Collective. Chicago, Illinois: Haymarket Books.
Vogel, Lise. 1971. “Modernism and History” (Avec Lillian Robinson). New Literary History, 3:l (automne), 177–199.
—. 1974. “Fine Arts and Feminism: The Awakening Consciousness”. Feminist Studies, 2:1, 3–37.
—. 1983. Marxism and the Oppression, of Women: Toward a Unitary Theory. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
—. 1991. “Telling Tales: Historians of Our Own Lives.” Journal of Women’s History, 2:3 (Winter), 89–101.
—2000. “Domestic Labor Revisited”. Science and Society, 64:2, 151–170. Réimprimé dans Vogel, 2013, 183—198. Science & Society, vol. 82, n° 2 (avril 2018), p. 275–287.
—. 2013 (1983). Marxism and the Oppression of Women: Towards a Unitary Theory. Édition révisée. Leiden, The Netherlands: Brill/Boston, Massachusetts: Haymarket.
Wallis, Victor. 2015. “Intersectionality’s Binding Agent: The Political Primacy of Class.” New Political Science, 37:4 (Décembre), 604–619.
Weigand, Kate. 2001. Red Feminism: American Communism and the Making of Women’s Liberation. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press.
Notes