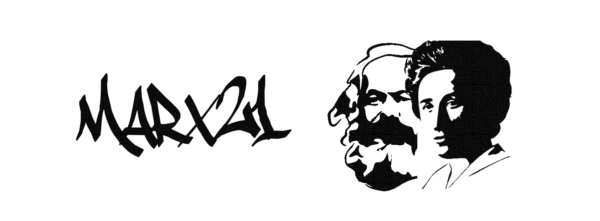L’ouvrage d’Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, a eu une influence particulière. En termes purement quantitatifs, celle-ci est considérable : selon Google Scholar, les citations de l’édition de 1973 de son magnum opus sont passées de 71 en 1990 à 1 483 en 2025. Mais la plupart des commentateurs politiques et des intellectuels publics abordent ce livre comme un réservoir de bons mots plutôt que comme un argumentaire cohérent. Ils sélectionnent ses réflexions sur le mensonge, l’utilisation du langage, le glissement entre pouvoir formel et informel dans les États autoritaires. En revanche, ils ignorent les thèses explicatives centrales de l’ouvrage. Quelles sont-elles et sont-elles plausibles ?

Arendt
Publié en 1951, Origins analyse deux régimes : l’Allemagne nazie et la Russie stalinienne. Arendt avance deux arguments fondamentaux, l’un causal et l’autre classificatoire. L’argument causal est que la condition préalable essentielle à l’émergence du totalitarisme est le phénomène d’« atomisation sociale », lui-même conséquence de l’émergence d’une « société sans classes ».[1] Elle développe ce point dans plusieurs passages sur différents registres. Ainsi, les nazis et les communistes « recrutaient leurs membres parmi cette masse de personnes apparemment indifférentes, que tous les autres partis avaient abandonnées, les jugeant trop apathiques ou trop stupides pour mériter leur attention ». [2]
Leurs partisans étaient des masses issues « des fragments d’une société hautement atomisée dont la structure compétitive et la solitude concomitante de l’individu n’étaient contenues que par l’appartenance à une classe ». [3] La Première Guerre mondiale avait amorcé le processus de « désintégration des classes et de leur transformation en masses ». [4] Ainsi, l’atomisation sociale qui accompagne l’absence de classes est la cause fondamentale du totalitarisme.
L’argument classificatoire est que le nazisme et le stalinisme, malgré leurs différences apparentes, étaient des types de régime fondamentalement similaires en ce sens qu’ils étaient tous deux basés sur le remplacement du système des partis par un « mouvement de masse », un transfert du pouvoir de « l’armée à la police » et la mise en œuvre « d’une politique étrangère visant à la domination mondiale ». [5]
Sur le plan idéologique également, les régimes étaient similaires, car ils se justifiaient tous deux en prétendant incarner une loi du développement historique : dans le cas des nazis, une lutte darwinienne pour l’existence ; dans le cas des staliniens, une lutte pour établir une utopie socialiste. Dans les deux cas, la terreur de masse était l’instrument utilisé pour atteindre cet objectif. Comme l’a souligné Arendt :
La terreur est la réalisation de la loi du mouvement ; son objectif principal est de permettre à la force de la nature ou de l’histoire de se déployer librement à travers l’humanité, sans être entravée par aucune action humaine spontanée. [6]
Arendt est une essayiste d’une érudition intimidante qui a parcouru tout le paysage de la pensée européenne et maîtrisait plusieurs langues. On peut supposer que c’est précisément cette érudition qui a conduit certains chercheurs à éviter d’examiner ses principales thèses socio-historiques, comme si le fait de s’intéresser à son travail de cette manière était en quelque sorte maladroit. Mais Les origines… est clairement destiné à être une explication du totalitarisme et doit être discuté en tant que telle. [7] La première question à se poser est de savoir si l’Allemagne de Weimar ou la Russie pré-stalinienne étaient vraiment des sociétés « sans classes ». De toute évidence, non, du moins si le terme « classe » — qu’Arendt ne définit jamais — est pris dans son sens habituel, celui d’un groupe formé sur la base des relations de propriété.
Prenons d’abord le cas allemand : l’un des tournants les plus décisifs sur la voie du national-socialisme a été la décision de la direction du Parti social-démocrate de détruire la révolution allemande en s’alliant avec les Freikorps, ce qui a eu pour conséquence désastreuse de préserver non seulement le pouvoir des industriels de la Ruhr, mais aussi celui des propriétaires terriens et des bureaucrates de l’Elbe orientale. [8]

Les conséquences néfastes de cette préservation de la société de classes allemande pour la santé de la démocratie de Weimar sont évidentes ; le point important dans l’argumentation d’Arendt est que ce n’est pas la création d’une société sans classes, mais plutôt le maintien d’une forme particulière de société de classes qui a été l’une des principales conditions préalables au national-socialisme.
À première vue, Arendt semble plus solide dans son analyse de la Russie. Mais l’expérience postrévolutionnaire de ce pays pose des problèmes à son raisonnement, ce qu’Arendt elle-même (à son grand mérite) reconnaît. Contrairement à de nombreux autres intellectuels anticommunistes, Arendt avait une conscience aiguë de la différence marquée entre la Russie sous Lénine et la Russie sous Staline. [9] Dans les années 1920, sous Lénine, la Russie a connu le développement rapide d’une paysannerie indépendante, propriétaire terrienne, d’une classe ouvrière organisée et d’une « nouvelle classe moyenne issue de la NEP [Nouvelle politique économique] ». [10]
Mais cela posait un problème analytique pour le récit d’Arendt : selon sa théorie, l’« absence de classes » est l’une des conditions préalables essentielles au totalitarisme, or, dans la période précédant immédiatement le totalitarisme, la Russie a connu une formation rapide des classes. Ainsi, pour la Russie, elle a inversé la causalité de son cadre de référence de base pour suggérer que l’absence de classes et son corollaire, l’atomisation, étaient le résultat plutôt que la condition préalable du totalitarisme. Mais cela soulève alors la question suivante : pourquoi le totalitarisme a-t-il émergé en Russie si sa condition préalable principale faisait défaut ?
Ces brèves remarques suffisent à montrer que l’idée selon laquelle une « société sans classes » était en quelque sorte une condition préalable au totalitarisme est en contradiction flagrante avec les données historiques des deux cas sur lesquels repose le récit d’Arendt. En Allemagne, c’est précisément la préservation d’un certain type de société de classes qui a causé le nazisme, tandis qu’en Russie, le stalinisme a été immédiatement précédé par la formation de classes pendant la période de la NEP.

Peut-être, cependant, le processus d’atomisation sociale pourrait-il se produire indépendamment de la destruction des classes. Si tel était le cas, il devrait être possible de reconstruire le récit d’Arendt dans une veine plus tocquevillienne, comme une théorie de la société civile ou de son absence, plutôt que des classes et de leur absence. Mais cela semble également peu plausible. Les preuves sont ici plus solides pour les cas fascistes que pour l’Union soviétique, et il convient de souligner qu’Arendt a toujours exclu l’Italie de la catégorie des « régimes totalitaires » parce qu’elle estimait que ce régime n’était pas suffisamment radical (bien que le terme « totalitaire » soit une invention italienne).
Néanmoins, en Italie et en Allemagne, la société civile était très développée avant la prise de pouvoir autoritaire. Les coopératives, les églises, les syndicats, les partis politiques et les sociétés d’entraide avaient connu une période de croissance massive dans les deux pays à partir de 1870. L’idée selon laquelle l’Allemagne ou l’Italie préfascistes étaient des sociétés de masse atomisées est donc assez trompeuse, compte tenu de la robustesse de leurs sociétés civiles. Il en va peut-être de même pour la Russie, comme le souligne Arendt dans son analyse de Lénine, qu’elle décrit comme ayant tenté de créer une sphère associative par le haut en promouvant les organisations professionnelles, en mettant l’accent sur les différences de nationalité et en encourageant délibérément le développement de toutes sortes d’organisations intermédiaires entre l’État et les individus.
Et qu’ont fait les totalitaires (qu’ils soient staliniens ou nazis) de ce matériau organisationnel, c’est-à-dire de la société civile, une fois au pouvoir ? Ils l’ont mise au service des objectifs du régime. En effet, Arendt le reconnaît indirectement dans son analyse du développement organisationnel du national-socialisme, avec ses nombreuses associations professionnelles pour « les enseignants, les avocats, les médecins, les étudiants, les professeurs d’université, les techniciens et les ouvriers ». [11] La raison de cette prolifération organisationnelle est évidente : comment ces régimes auraient-ils pu mobiliser les masses sans ces associations ?
En tant qu’explication causale, Les origines… est donc voué à l’échec : ni l’absence de classes ni l’atomisation sociale n’expliquent le totalitarisme. Mais ce critère est peut-être injuste pour aborder le livre, qui doit être compris comme proposant une classification plutôt qu’une explication. Dans ce cas, la question clé est de comprendre le totalitarisme lui-même. Ce n’est guère plus facile, car Arendt évite de conceptualiser explicitement le phénomène, se contentant d’insister à plusieurs reprises sur sa nouveauté radicale. [12] Elle se rapproche le plus d’une définition à la toute fin du livre, où elle identifie quatre éléments : la transformation des « classes en masses », l’émergence d’un « mouvement de masse », le pouvoir accru de la police par rapport à l’armée et « une politique étrangère ouvertement orientée vers la domination mondiale ». [13]
Le premier de ces critères prête à confusion, car l’atomisation ou la massification est initialement présentée comme une cause du totalitarisme plutôt que comme un résultat (sauf, de manière incohérente, dans le cas de la Russie). Le deuxième est difficile à cerner. Comment faire la différence entre un régime fondé sur un mouvement de masse et un régime fondé sur un parti unique ? Le troisième semble relativement clair, mais pourrait vraisemblablement décrire n’importe quel régime policier.
Les problèmes liés au quatrième critère sont plus révélateurs, car la volonté de domination mondiale décrit une différence entre le nazisme et le stalinisme plutôt qu’une similitude. Hitler était un joueur géopolitique prêt à tout risquer. Staline, partisan du socialisme dans un seul pays, était extrêmement prudent sur la scène internationale, et son accession au pouvoir était en effet inextricablement liée au déclin des ambitions révolutionnaires mondiales de la révolution d’Octobre et à l’exil et l’assassinat de son plus grand théoricien, Léon Trotsky. Ainsi, dans le cas de la Russie, la consolidation du totalitarisme n’a pas été définie par une volonté de « domination mondiale », mais par le renoncement à un tel projet.

Les origines… est donc un classique paradoxal dans le sens où son projet explicatif et classificatoire fondamental est largement infructueux. Cela ne veut pas dire que le livre n’apporte rien. Arendt est beaucoup plus convaincante lorsqu’elle décrit la phénoménologie du fascisme ; sa description de l’absence de forme de l’État nazi, avec ses satrapes s’efforçant de deviner la « volonté du chef », est très pertinente. [14] Elle est également très douée pour décrire l’attrait des théories du complot. Comme elle le dit, « la foule croyait vraiment que la vérité était tout ce que la société respectable avait hypocritement ignoré ou dissimulé sous la corruption ». [15] Mais pour un compte rendu des régimes les plus terribles du XXe siècle, il vaut mieux se tourner ailleurs.
Gramsci
Antonio Gramsci, l’énigmatique Sarde, est une alternative valable. Il jouit d’une pertinence continue et d’un public encore plus assidu que celui d’Arendt. Mais leurs affirmations comparatives ont rarement été mises en parallèle. Les raisons ne sont pas difficiles à trouver, car les deux penseurs étaient triplement éloignés l’un de l’autre : par la langue, par la sympathie politique et par la génération. Cependant, leurs préoccupations étaient similaires à certains égards, et même certaines de leurs analyses historiques spécifiques présentent des similitudes frappantes. Voici Arendt :[16]
La victoire étonnamment facile de la révolution d’Octobre s’est produite dans un pays où une bureaucratie despotique et centralisée gouvernait une population massive et déstructurée, qui n’avait été organisée ni par les vestiges de l’ordre féodal rural, ni par les classes capitalistes urbaines naissantes et faibles.
L’analyse de Gramsci était presque identique : [17]
En Russie, l’État était tout et la société civile était primitive et informe ; en Occident, il existait une relation appropriée entre l’État et la société civile, et lorsque l’État tremblait, la structure solide de la société civile se révélait immédiatement.
Mais c’est précisément là où ils sont les plus proches, que les différences dans leurs analyses sont les plus évidentes. Car Gramsci ne considérait pas l’entre-deux-guerres en Occident comme une période d’atomisation et d’isolement : elle était caractérisée par une crise générée par le développement massif de la société civile, et non par son effondrement, et encore moins par la disparition des classes.
Du point de vue de Gramsci, le problème était que les libéralismes faibles de l’Europe du XIXe siècle étaient soudainement confrontés à des populations hautement organisées et politisées dont les revendications démocratiques ne pouvaient être canalisées vers les institutions représentatives telles qu’elles existaient alors. Bien que Gramsci n’ait pas utilisé le terme « totalitarisme » au sens où l’entend Arendt, la cause fondamentale du fascisme était exactement opposée à celle proposée dans Les Origines du totalitarisme.
La conjoncture actuelle
Où tout cela nous mène-t-il aujourd’hui ? Que faire d’Arendt et de Gramsci, de l’atomisation, de la société civile et du totalitarisme ?
Du point de vue des arendtiens et de toute la littérature sur la société de masse que son œuvre a engendrée, la situation est contradictoire. Les conditions préalables fondamentales du totalitarisme semblent réunies : isolement, atomisation et solitude. Beaucoup ont cherché à les relier au phénomène du trumpisme. Mais quels que soient les dangers que MAGA puisse représenter, et ceux-ci sont très sérieux, même les maximalistes les plus convaincus ne pourraient le décrire comme un mouvement totalitaire au sens arendtien. Tout d’abord, il manque une théorie globale de l’histoire, et qui pourrait décrire la politique étrangère brutale, mais erratique et empreinte d’amateurisme, émanant de la Maison Blanche comme une volonté de domination mondiale ? Ainsi, nous semblons avoir la cause (l’atomisation sociale) sans l’effet (la domination totalitaire).
Qu’en est-il du point de vue gramscien ? Ici, le problème est inverse. Bien qu’il y ait eu récemment une augmentation de la participation politique, les sociétés civiles occidentales, et en particulier aux États-Unis, sont-elles aussi mobilisées qu’elles l’étaient dans l’entre-deux-guerres ? C’est peu probable. Et pourtant, il semble y avoir une crise de légitimité de la démocratie occidentale (une « crise d’hégémonie », aurait dit Gramsci), dont Trump est l’une des expressions, mais pas la seule. Ici, il y a l’effet sans la cause.
La meilleure façon de comprendre ce qui se passe est peut-être de se concentrer sur le problème de la politique. Le véritable enjeu en Occident aujourd’hui n’est pas une rupture révolutionnaire menaçante produisant en contrepartie une réponse contre-révolutionnaire, mais plutôt un affaiblissement des liens entre la sphère privée et associative et la sphère politique. Cette scission a créé une rupture entre les représentants politiques et les groupes qu’ils étaient censés représenter : une fracture qui était la plus évidente au sein du Parti républicain à partir de 2015, mais qui avait son pendant dans la révolte de la nouvelle gauche du Parti démocrate. Ce qui se produit actuellement, c’est une restructuration naissante de ces liens sur un terrain encore en cours de formation. Il ne s’agit pas d’être « pour » ou « contre » la société civile, mais plutôt de savoir qui contrôlera le processus de son articulation politique.
Il est particulièrement important de comprendre que MAGA ne souhaite pas détruire la société civile en tant que domaine des associations et des groupes d’intérêt (ce qui est une autre raison évidente pour laquelle il ne peut être considéré comme un mouvement totalitaire au sens des Origines…). Au contraire, MAGA cherche à coloniser ce domaine : il n’encourage pas le désengagement civique, mais tente de promouvoir ses propres formes d’engagement.
Les exemples abondent : l’exhortation de J.D. Vance dans le podcast de Charlie Kirk à « s’impliquer, s’impliquer, s’impliquer » après avoir expliqué que « la société civile n’est pas seulement quelque chose qui découle du gouvernement, elle découle de nous tous » en est un exemple évident. Il en va de même pour les efforts récents de Ryan Walters, ancien directeur des écoles publiques de l’Oklahoma, pour encourager la création d’une section de Turning Point USA [L’organisation étudiante de MAGA, NDT] dans chaque lycée et université de l’État.
Il s’agit d’une lutte pour l’hégémonie menée sur le terrain de la société civile, ce que Gramsci aurait appelé une guerre de position, et non d’une lutte pour ou contre la société civile en tant que domaine mythique de consensus prépolitique et de résolution pratique des problèmes.
La gauche américaine est fortement désavantagée dans ce combat. Ses intellectuels, largement cantonnés dans le monde universitaire et, dans une moindre mesure, dans le monde des organisations à but non lucratif, ont peu accès aux partis politiques ou aux mouvements sociaux. Ils sont donc isolés des forces politiques et sociales nécessaires pour se joindre à la lutte.
Mais c’est là que réside une ironie dont les trumpistes ne se rendent pas compte. Loin d’exercer une grande influence culturelle, les intellectuels de gauche et progressistes constituent depuis des décennies une classe privilégiée mais largement insignifiante au sein du complexe universitaire/ONG, où ils ont formé ce que Gramsci aurait appelé une intelligentsia traditionnelle qui s’exprime dans son propre langage plutôt ésotérique.

Il n’est pas impossible que la tentative de l’administration Trump de détruire le cordon sanitaire qui isole ces intellectuels du monde politique crée les conditions leur permettant d’établir un lien plus étroit avec la politique. De cette manière, Trump aurait contribué à la création d’un nouveau prince moderne adapté à l’ère des médias sociaux, de la viralité et de l’intelligence artificielle. MAGA se révélerait être l’accoucheur de ce qu’il craint le plus.
Et qu’en est-il des Origines… ? Peut-être que ce qui a rendu ce texte si célèbre, à savoir sa facilité extrême à décrire le sentiment d’autoritarisme, est précisément ce qui en fait un instrument trop brut, voire totalement trompeur, pour comprendre le présent. Afin de nous orienter, nous avons davantage besoin d’explications que de phénoménologie. Et pour cela, il vaut mieux se tourner vers le plus grand penseur politique du XXe siècle plutôt que vers le métaphysicien de la domination totale.
* Cet article est paru le 11 décembre 2025 sur le site The Ideas Letter. https://www.theideasletter.org/essay/beyond-arendt-and-gramsci/ Notre traduction de l’anglais.
Dylan Riley est professeur de sociologie à l’université de Californie, Berkeley. Il étudie le capitalisme, le socialisme, la démocratie, l’autoritarisme et les régimes de connaissance dans une perspective comparative et historique, et est l’auteur ou le coauteur de six livres et de nombreux articles.