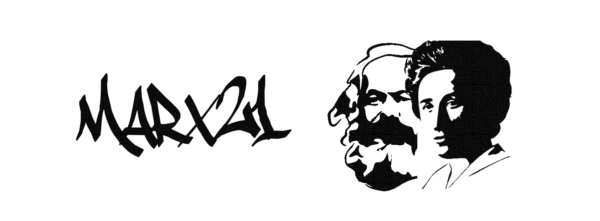Dans cet entretien réalisé par Jean Batou, Gilbert Achcar revient sur l’issue des soulèvements de la région arabe, quinze ans après la chute de Ben Ali en Tunisie.
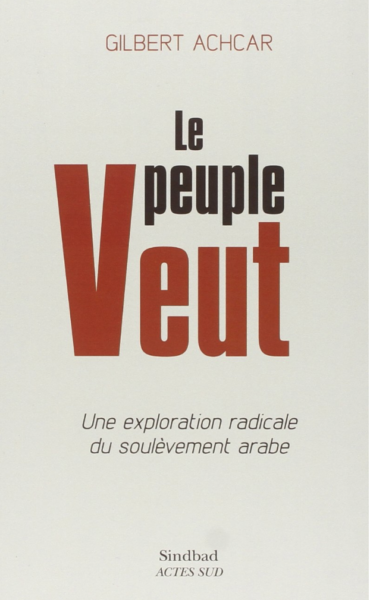
Jean Batou: Le 14 janvier 2026 marque le 15e anniversaire de la chute du régime de Ben Ali, qui a constitué la première grande victoire du « Printemps arabe ». Après la Tunisie, de nombreux autres peuples se sont lancés dans des luttes de masse, notamment en Égypte et en Syrie. Pourtant, cette imposante vague révolutionnaire a pu être endiguée par des guerres civiles sanglantes, alimentées par des interventions étrangères (groupes jihadistes, pays du Golfe, Iran, Turquie, Russie, etc.), mais aussi par la répression des États en place, conduisant à la réinstallation de régimes autoritaires. Quel bilan tires-tu de cette longue séquence?
Gilbert Achcar: Le bilan est à présent fort négatif. Le régime démocratique en Tunisie, dernier des grands acquis démocratiques de la vague de soulèvements de 2011 communément désignée sous le nom de « printemps arabe », a été renversé par un coup d’État endogène en 2021, dix ans après. La résistance populaire contre le coup d’État au Soudan, dernier bastion de la vague révolutionnaire de 2019 qui a été qualifiée de « deuxième printemps arabe », s’est trouvé noyé dans la guerre qui a éclaté en 2023 entre les deux composantes armées du régime militaire. C’est sur cet arrière-plan de défaites qu’est survenue la guerre génocidaire menée par Israël contre la population de Gaza, dans le cadre d’une escalade dramatique de l’offensive sioniste contre le peuple palestinien et contre les ennemis régionaux d’Israël.
Mais ce bilan d’étape négatif s’inscrit dans le contexte de ce que j’ai analysé dès le départ comme un « processus révolutionnaire à long terme », lorsque dominaient les illusions que traduisait l’appellation « printemps arabe ». Il était clair à mes yeux qu’il ne s’agissait pas d’une transition démocratique relativement brève, à la manière de ce qu’avaient connu les États d’Europe centrale et orientale à la fin des années 1980. Les bureaucraties de ces États n’avaient opposé qu’une faible résistance à la vague montante d’un changement politique imposé par une crise profonde du mode de production bureaucratique et soutenu par un impérialisme occidental triomphaliste au faîte de sa puissance. Et ce changement politique ne consistait qu’à s’adapter au modèle promu par cet impérialisme occidental en se laissant glisser sur une pente de moindre résistance.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les choses étaient tout autres, et le restent. Là, les catégories dirigeantes sont possédantes – parfois même possessives de l’État lui-même – et s’opposent farouchement au changement politique radical requis pour débloquer le développement économique et satisfaire les aspirations sociales des populations, un changement très contraire aux intérêts de l’impérialisme occidental dans la région.
La difficulté du changement devait toutefois avoir pour conséquence un blocage historique prolongé puisque la crise structurelle restait irrésolue : la crise socioéconomique n’a pas cessé de s’aggraver et le contexte politique de se détériorer. Cette détérioration s’est manifestée par une série de guerres civiles – Syrie, Libye, Yémen, et maintenant Soudan – qui contribuent à la démoralisation et à la démobilisation des populations régionales. Mais la stabilité de l’ordre ancien ne saurait être rétablie : le blocage structurel alimente nécessairement des tensions sociales qui se traduisent tôt ou tard par des explosions politiques. Un « processus révolutionnaire à long terme » peut durer plusieurs décennies et, s’il se heurte à un blocage continu, peut entraîner un effondrement civilisationnel généralisé dans la région affectée. Les deux termes de l’alternative sont ainsi la révolution sociale et la barbarie.

Maroc: manifestation devant le consulat d France contre le soutien de Paris à Israël
Peut-on considérer l’établissement de l’administration autonome du Parti de l’union démocratique (PYD) au Rojava et la chute finale du régime syrien d’Assad comme des résultats de ce cycle révolutionnaire, même si l’avenir de la Syrie demeure très incertain? Par ailleurs, le soulèvement récent de la jeunesse marocaine ne montre-t-il pas que la crise sociale est toujours aussi profonde dans toute la région?
L’administration autonome kurde dans le nord-est syrien ne fait pas partie intégrante du processus révolutionnaire en cours dans l’espace arabophone. Elle en est un dérivé, rendu possible par la guerre civile qui a affaibli l’État syrien et l’a conduit à tolérer l’existence de cette administration régionale. Celle-ci a d’emblée pris ses distances par rapport à l’affrontement entre le régime syrien et l’opposition. Elle s’est alliée avec les États-Unis dans le combat contre Daech (l’État islamique).
Par ailleurs, la combinaison de l’ingérence des monarchies pétrolières, des manœuvres machiavéliques du régime syrien et de l’inaptitude de la gauche présente dans le mouvement populaire syrien ont fait que le soulèvement révolutionnaire dans ce pays n’a pas tardé à muer en guerre civile entre deux camps contre-révolutionnaires : le régime Assad d’une part, et diverses forces armées appartenant au champ politique de l’intégrisme islamique de l’autre.
C’est la plus réactionnaire d’entre ces dernières – le Front al-Nusra, ex-branche d’al-Qaida, qui a gouverné la région d’Idlib au nord du pays depuis quelques années et a entretenu des rapports avec l’État turc (longtemps inavoués par celui-ci) – qui a finalement tiré les marrons du feu lors de l’écroulement du régime Assad. Ce dernier est tombé parce qu’il a été lâché par la Russie, embourbée dans l’invasion de l’Ukraine, puis par l’Iran, devenu incapable d’intervenir, surtout après la décapitation du Hezbollah libanais par Israël à l’automne 2024. Le nouveau pouvoir établi à Damas, relooké après Idlib mais conservant les mêmes paramètres pour l’essentiel, est un pouvoir réactionnaire, confessionnel et antidémocratique, et bien sûr partisan du capitalisme le plus cru. C’est bien pourquoi il a tout de suite été embrassé par Donald Trump et les capitales occidentales.
Par contre, le récent mouvement de la jeunesse marocaine s’inscrit pleinement, quant à lui, dans la continuité du processus révolutionnaire enclenché en 2011. Il en illustre parfaitement les racines profondes, ce blocage développemental avec une croissance anémique dont le symptôme principal était et reste le chômage des jeunes. La région Moyen-Orient-Afrique du Nord détient le taux record mondial de ce chômage depuis des décennies. C’est la désespérance des jeunes, en particulier, qui est la force motrice des soulèvements régionaux.
Si les causes qui ont provoqué cette chaîne de soulèvements populaires restent présentes, quelles raisons permettent de comprendre le recul actuel des mobilisations sociales dans la plupart des pays? Cela est-il dû aux effets à long terme de la répression? À l’épuisement des secteurs qui ont été à l’avant-garde de ces combats? À l’absence de directions politiques offrant une perspective de rupture avec le capitalisme néolibéral mafieux et/ou avec l’islamisme réactionnaire?
La raison primordiale est l’absence de mouvement politique structuré représentant les aspirations révolutionnaires de la jeunesse de manière indépendante des oppositions politiquement réformistes ou socialement réactionnaires. Ces oppositions ont pu détourner en partie l’énergie révolutionnaire des masses, aboutissant à un rapport triangulaire entre un pôle révolutionnaire et deux pôles contre-révolutionnaires. On s’est le plus approché de ce qui a fait défaut avec la révolution soudanaise, dont le fer de lance a été constitué par des comités de jeunes radicalisés dans les quartiers – les « comités de résistance », une structure décentralisée, mais capable d’unité d’action grâce à l’usage des technologies modernes de la communication pour se concerter. Ce qui manquait au chapitre, c’était une organisation politique qui aurait su préparer le terrain à la révolution en construisant un réseau dans les forces armées, ou du moins aurait agi pour la construction d’un tel réseau une fois la révolution enclenchée. Cela seul aurait permis d’éviter que la révolution soit étouffée par une guerre intestine entre militaires réactionnaires.

Réunion d’un comité de résistance soudanais
C’est aussi ce qui manque le plus au Maroc : le mouvement de la jeunesse, connu sous le nom de « GenZ 212 », est bien moins structuré que les « comités de résistance » soudanais, et manque encore plus qu’eux de répondant politique à la hauteur des enjeux. La répression ne saurait être donnée pour cause en elle-même puisqu’elle fait partie des obstacles inévitables à surmonter, et dont on sait la dureté extrême dans cette partie du monde. La question est précisément comment s’organiser pour vaincre cette répression. Et c’est là que le facteur organisationnel devient primordial.
Dans quelle mesure la « nécropolitique » menée par Israël à Gaza ou par les EAU au Soudan a-t-elle porté un coup très dur à la combativité des peuples palestiniens et soudanais?
Ces deux situations sont peu comparables. La guerre génocidaire menée par Israël contre la population de Gaza est une offensive contre le peuple palestinien dans son ensemble. Les Émirats arabes unis n’interviennent pas directement au Soudan : ils soutiennent un des deux camps de la guerre entre militaires, les « Forces de soutien rapide » dont l’origine remonte aux paramilitaires qui ont perpétré le génocide du Darfour il y a une vingtaine d’années. Comme il a été déjà dit, la guerre qui a éclaté au Soudan a étouffé le processus révolutionnaire en cours depuis 2019. Son impact régional est, par contre, limité. En revanche, la guerre génocidaire menée par l’État sioniste à Gaza a certainement eu un impact régional majeur. Elles s’est ajoutée aux défaites accumulées depuis le « printemps arabe » pour accroître une démoralisation impuissante, mêlée à un sentiment d’exaspération parmi les peuples de la région. Je crois que l’exaspération finira par l’emporter en conséquence d’une combinaison explosive des frustrations – socioéconomique et politique à l’échelle de chaque pays, et politique et sentimentale à l’échelle régionale.

Bande de Gaza: dans les ruines de Khan Younès
L’émergence de sous-impérialismes moyen-orientaux militairement et financièrement de plus en plus puissants et agressifs, comme l’Arabie Saoudite, les EAU et Israël, disposés à poursuivre leurs intérêts par tous les moyens, ne pose-t-elle pas des problèmes croissants aux États-Unis? Je pense notamment à la fébrilité guerrière d’Israël vis-à-vis de plusieurs de ses voisins, jusqu’à son bombardement du Qatar, mais aussi à la rivalité entre Émiratis et Saoudiens au Soudan.
Les rivalités entre vassaux de l’impérialisme profitent à l’impérialisme dans la mesure où elles augmentent la dépendance de chaque État vassal envers le suzerain, les États-Unis en l’occurrence. Washington se garde bien de prendre partie dans ce type de rivalités, mais exerce plutôt un rôle modérateur et agit au besoin pour réconcilier ses clients. Ainsi, la première administration Trump (2017-2020) avait donné son feu vert au boycott des Qataris par les Émiratis et Saoudiens, tout en maintenant ses rapports avec l’émirat de Qatar, hôte de la principale base militaire étatsunienne dans cette partie du monde. Le boycott prit fin au terme du premier mandat de Trump. Lors de son second mandat, celui-ci a radicalement changé de politique à l’égard des Qataris qui l’ont littéralement soudoyé – un art dans lequel les Qataris excellent.
Le cas de Netanyahou est différent : il peut y avoir des désaccords mineurs entre Trump et lui, mais chacun des deux prend soin de les circonscrire. Netanyahou est passé maître dans l’art d’amadouer Trump. Il laisse faire au besoin, comme c’est le cas pour le soi-disant « plan de paix », dont Netanyahou est convaincu qu’il n’ira pas loin, et s’enlisera forcément à court ou moyen terme. Quant à la « fébrilité guerrière » d’Israël, elle a non seulement été approuvée par Washington, mais les États-Unis y ont directement concouru – plus directement encore sous Trump, qui a ordonné à ses forces armées de contribuer au bombardement de l’Iran. Vu les intérêts personnels et familiaux qu’il a maintenant avec les Qataris, Trump ne pouvait que se désolidariser de la tentative israélienne d’assassinat de dirigeants du Hamas au Qatar. Mais il l’a fait bien mollement, et a aussitôt agi pour réconcilier ses deux alliés.
Les monarchies pétrolières du Golfe, les monarchies jordanienne et marocaine, l’Égypte et Israël constituent autant de composantes d’un dispositif régional étroitement lié aux États-Unis. Tous ces États dépendent de Washington d’une façon ou d’une autre, et leurs rôles sont complémentaires plutôt qu’antithétiques. Leur complémentarité a été à l’œuvre de manière flagrante à l’occasion du génocide perpétré par Israël à Gaza.
* Entretien réalisé le 25 décembre 2025. Traduit en anglais par Jacobin, en espagnol par Viento Sur et en portugais par Esquerda.net.